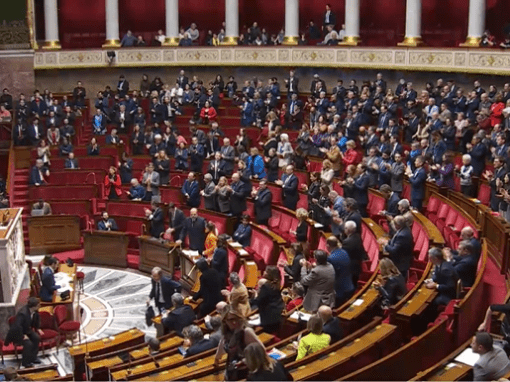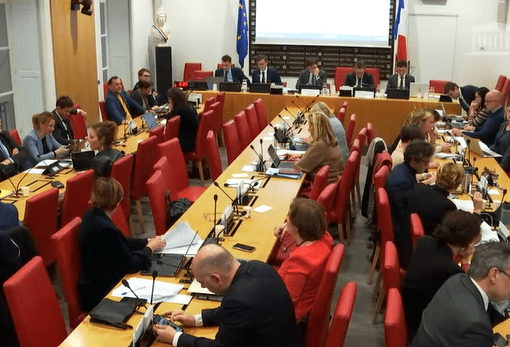Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à discuter, le 24 janvier, le projet de loi constitutionnelle visant à garantir « la liberté de la femme d’avoir recours à l’avortement », Grégor Puppinck, docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), explique que l’avortement n’est ni une liberté, ni un droit.
Manifestement, le Gouvernement ne sait pas ce qu’est une liberté, et ce qui la distingue d’un droit. Après bien des hésitations, il propose d’ajouter à la Constitution une phrase alambiquée disant que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
Une telle phrase, quand on la compare à la qualité juridique de la Constitution, est symptomatique d’une forme de décadence. D’abord quant à son objet, car l’avortement n’a rien à faire dans une Constitution (cf. IVG : une révision constitutionnelle dépourvue de sens). Ensuite, quant à son expression, car parler de « liberté garantie » est redondant. Plus encore, c’est toute la phrase qui l’est, car elle n’ajoute rien à ce qui est déjà, à savoir que la loi organise l’accès à l’IVG. La seule nouveauté consiste à inscrire dans la Constitution que l’IVG est une « liberté ». Mais là encore, c’est maltraiter le droit.
Des « notions essentielles » mais inapplicables à l’avortement
Il convient de rappeler brièvement ce que sont une liberté et un droit, et donc pourquoi ces notions essentielles ne peuvent pas s’appliquer à l’avortement.
Une liberté est une faculté naturelle de la personne que l’Etat s’engage à respecter, parce qu’il estime que cette faculté est bonne. Il s’agit, par exemple, des libertés d’expression, de pensée, de mouvement ou d’entreprise. Toute personne possède naturellement ces facultés, et tout ce que l’on demande à l’Etat, c’est de ne pas en entraver l’exercice, d’en garantir le « libre exercice », sans que cela nuise à autrui (cf. IVG dans la Constitution : une « liberté » ne peut pas être subie).
Il en va très différemment d’un droit. Un droit n’est pas une faculté naturelle de la personne, mais une chose, un « bien » que l’on peut réclamer à autrui, et finalement à l’État au nom de la justice. À la différence d’une liberté, un droit suppose une relation avec un tiers, et consiste en une obligation de l’un envers l’autre. Il va de soi que personne ne possède un droit d’avorter à l’égard d’un tiers (cf. Le « droit à l’avortement » n’est pas légitime « parce qu’une majorité d’individus ou d’Etats l’affirment »).
Au plan collectif, la situation est un peu différente, car la garantie d’un droit répond à un besoin fondamental de la personne qu’elle ne peut pas satisfaire entièrement par elle-même, et qui nécessite donc l’intervention de la société. Il s’agit, par exemple, des besoins d’instruction, de santé ou de sécurité. Ces « besoins » ou droits sociaux découlent de la raison d’être de l’État, qui est de garantir la pérennité de la société. En cela, un droit s’oppose à une liberté, car il nécessite l’action d’un tiers, et finalement de l’Etat.
L’IVG est « le résultat de contraintes »
Dire que l’avortement est une « liberté », comme le propose le Gouvernement, est donc absurde, car l’IVG n’est pas une faculté naturelle de la personne (cf. L’avortement ne pourra jamais être un « droit fondamental », ni une « liberté »). C’est d’autant plus absurde que l’IVG est en réalité le résultat de contraintes diverses ; ce n’est pas un acte « libre ».
L’IVG, au contraire, pourrait entrer dans la catégorie du « droit » si l’on estimait que pouvoir avorter était un dû, une exigence de justice. Cela supposerait soit que l’avortement vienne « corriger » une injustice entre deux personnes, ce qui n’est évidemment pas le cas, soit que la société estime que l’avortement est un « besoin fondamental » de la personne, au même titre que l’instruction ou la santé. C’est sur ce terrain que se place la gauche. Mais cela suppose que l’avortement soit un bien en soi, au même titre que la santé ou la sécurité. Or, ce n’est évidemment pas le cas. Pour preuve, personne n’avorte par « plaisir » (cf. « Deuil caché » : « une réhabilitation de la souffrance » des femmes qui ont avorté).
« L’avortement est un mal que l’on ne souhaite à personne »
En fait, l’avortement est un « mal » que l’on ne souhaite à personne et, comme tel, il ne peut être ni une liberté, ni un droit. Ainsi, dans la loi Veil, l’avortement est seulement toléré dans certaines circonstances, comme un « moindre mal ».
Un « moindre mal » s’exprime toujours en droit comme une exception à un principe, en l’occurrence au respect de la vie et de la dignité humaine, mais jamais comme un droit ou une liberté en soi (cf. « L’avortement n’est pas un droit. Il demeure une dérogation au respect de la vie. »). Encore faut-il que ce « moindre mal » permette de préserver un bien aussi grand que le mal auquel il est consenti, à savoir la vie de la mère.
On ne peut pas faire dire n’importe quoi au droit. Un mal, même estimé nécessaire, ne peut pas être un droit ou une liberté, mais seulement une exception. Il serait bon que le législateur s’en souvienne. C’est pour cette raison que le Gouvernement et le Parlement se sont empêtrés en cherchant une formulation. Le droit obéit à une rationalité propre qui est celle de la justice. Il appartient au législateur de la servir, et non de s’en servir à des fins politiciennes.
Si le législateur voulait vraiment faire le bien, il regarderait en face les statistiques d’avortements en France et en Europe (cf. France : 234 300 avortements en 2022). Il constaterait que la France fait figure d’exception, avec deux fois plus d’IVG qu’en Allemagne toutes proportions gardées. Que l’IVG baisse dans les autres pays, et continue d’augmenter en France. Si le législateur voulait vraiment faire le bien, il mettrait en œuvre une politique de prévention de l’avortement (cf. La prévention de l’avortement : garantir le droit de ne pas avorter).
Cette tribune a été initialement publiée par Valeurs actuelles. Elle est reproduite avec l’accord de l’auteur.