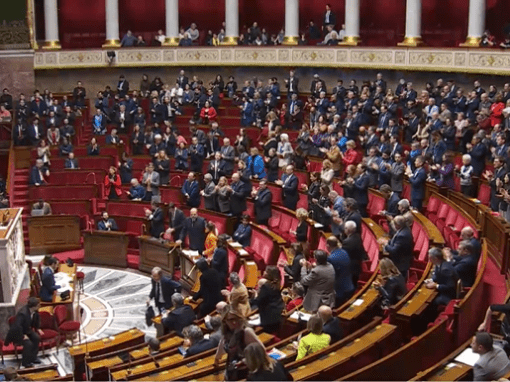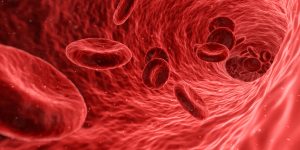« L’avortement fut légalisé trois ans plus tard, avec la loi sur l’IVG portée par son amie Simone Veil et le président Valéry Giscard d’Estaing. » C’est ce qu’a affirmé Emmanuel Macron dans un discours d’hommage à Gisèle Halimi le 8 mars dernier. A tort.
En effet, dans son article premier, la loi Veil disposait que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». Ainsi, le recours à l’avortement n’est qu’une possibilité « dérogatoire » au droit à la vie. En 1975, l’avortement a été dépénalisé, pas légalisé.
D’un point de vue juridique, il n’existe, ni dans la législation française, ni au niveau du droit du Conseil de l’Europe (CEDH), de « droit à l’avortement », rappelle Guillaume Drago, professeur français de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II (cf. Constitutionnalisation de l’avortement : « On ne joue pas avec la norme constitutionnelle » [Interview]). Pas plus qu’il n’existe de « droit à disposer de son corps » (cf. GPA, don d’organes, suicide… Est-ce que mon corps m’appartient ?).
« Gisèle Halimi par ses mots avait fait changer la loi », a déclaré Emmanuel Macron. Lui-même a sans aucun doute choisi les siens avec soin. Il a d’ailleurs préféré parler de « liberté des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse » plutôt que de « droit à l’avortement » (cf. Avortement dans la Constitution : un projet de loi en préparation). En matière de bioéthique le choix des mots n’est jamais neutre (cf. Fin de vie : un nouveau groupe d’experts pour “travailler sur les mots” ; La novlangue à la conquête de la bioéthique ?).