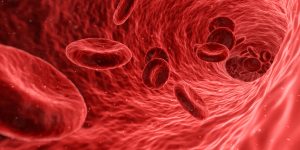Au fil du temps, les révisions de loi de bioéthique ont repoussé toutes les limites. Pourtant celles-ci sont inhérentes, indispensables à la vie humaine.
Etre limité est a priori peu élogieux. Et pourtant. Les limites, en dessinant le cadre, en donnant à voir où se situe la transgression, définissent aussi un possible. « La limite est le vivant même » affirment la journaliste Monique Atlan et le philosophe Roger-Pol Droit[1]. Elle est « nécessaire et décisive, comme condition organisatrice de la vie, de la pensée et de la société ». La limite a une « fonction protectrice ». Ainsi, poser un cadre n’enferme pas, mais circonscrit un domaine où évoluer en sécurité. Un espace de liberté. Une vérité bien connue des parents et des éducateurs.
La société, elle, refuse toute limite. Elle les voue aux gémonies et la loi ne fait plus autorité. « La norme morale est devenue relative, écrit l’avocat et essayiste François Sureau[2], avec cette conséquence paradoxale que le corps social ne cesse de réclamer un encadrement que les principes traditionnels ne lui donnent plus, tout en ne cessant de lui contester sa position d’autorité. »
A chacun, on intime de « se dépasser », de « repousser ses limites ». Physiquement bien sûr, mais pas seulement. Au-delà de lui-même, l’individu est appelé à « faire bouger les lignes ». La transgression est érigée en exemple. Les témoignages de ceux qui n’hésitent pas à contourner la loi prolifèrent, comme pour, par exemple, la gestation par autrui. Et ce, en dépit de l’interdiction légale (cf. « Ils font bouger les lignes » : le commerce de la fertilité en prime time).
La loi : un cadre mouvant
Les chercheurs aussi « font bouger les lignes ». Récemment, le Conseil d’Etat a fait annuler une autorisation d’étude sur des embryons humains accordée par l’Agence de la biomédecine (ABM), confirmant ainsi la décision de la Cour administrative d’appel de Versailles en 2018 (cf. Le Conseil d’État retoque une autorisation d’étude sur l’embryon humain). La loi pose des limites, l’Agence de la biomédecine semble ne pas les voir. Et pour les ajuster à cet état de fait, la loi suivante les repousse, toujours un peu plus loin. Comme le rappelle Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Lejeune, qui a suivi l’élaboration des quatre lois de bioéthique, et de cinq révisions des conditions de recherche sur l’embryon, les modalités ont été élargies par étapes (cf. Loi de bioéthique et recherche sur l’embryon : le législateur va-t-il réguler ou régulariser ?). « On a connu l’époque où la loi a interdit toute recherche (1994), puis a ouvert une dérogation temporaire (2004), puis a pérennisé cette dérogation (2011), puis a autorisé la recherche sous conditions (2013), puis a ouvert une dérogation dans la dérogation pour faciliter la recherche qui améliore la PMA (2016), puis supprime toutes les conditions (2019-2020). » Le législateur ne régule plus, il régularise.
Des limites à redécouvrir
Certes le champ des possibles ouverts par la technique ne cesse de progresser. Mais l’éthique ne se construit pas sur des sables mouvants. Progrès technique ne veut pas dire progrès éthique. Et « c’est l’éthique qui se trouve en péril, dans son fondement même, si on perd le sens des limites » préviennent Monique Atlan et Roger-Pol Droit[3]. Avec des conséquences pour l’homme. « Si l’offre biomédicale a démantelé la sexuation, le processus de vieillissement, la mortalité, s’agit-il d’un simple franchissement de limites, ou d’une attaque de l’humanité, dans toutes les figures de sa finitude ? », interroge la psychanalyste et écrivain Monette Vacquin, membre du Conseil Scientifique du département d’Ethique biomédicale du Collège des Bernardins[4].
L’homme est limité, la finitude est sa condition. Il doit composer avec ses limites physiques, intellectuelles, qu’il éprouve dans une temporalité elle aussi limitée. Et « un homme, ça s’empêche » écrivait Albert Camus. Pour rester homme, il s’agit de d’« accepter certains renoncements, refuser de faire tout ce qu’on désire, mettre des bornes à sa démesure, son agressivité, sa barbarie… »[5]. Retrouver le sens des limites, n’est-ce pas renouer avec l’humanité pour vivre en adulte laissant derrière soi l’enfant-roi, comme l’adolescent qui a pu tenter de se construire dans la transgression ? Pour Monette Vacquin, « que la “militance de la raison” ait été le masque, peut-être désespéré, du refus de toute limite », interroge le devenir de notre humanité.
[1] Faire face au piège de l’indifférenciation : Monique Atlan et Roger-Pol Droit s’interrogent sur le sens des limites, Valeurs actuelles (23/01/2021)
[2] Sans la liberté, François Sureau, éditions Tracts Gallimard, septembre 2019, p. 47
[3] Le Sens des limites, Monique Atlan et Roger-Pol Droit, éditions de l’Observatoire
[4] Monette Vacquin fait partie de la toute première génération à avoir travaillé ces questions, autour de Jacques Testart. Elle est co-auteur du « Magasin des enfants », sous la direction de Jacques Testart, folio, 1990, de « Main Basse sur les vivants », Fayard, 1999, « Frankenstein aujourd’hui, égarements de la science moderne », Belin, 2016. La citation est extraite de l’article « Réflexions sur la notion de “risque anthropologique” », in Le Vivant et la rationalité instrumentale sous la direction d’Isabelle Lasvergnas, Liber, cahiers de recherche sociologique, Montréal, 2003.
[5] Faire face au piège de l’indifférenciation : Monique Atlan et Roger-Pol Droit s’interrogent sur le sens des limites, Valeurs actuelles (23/01/2021)
Cet article de la rédaction Gènéthique a initialement été publié sur Aleteia sous le titre : Bioéthique : il n’y a pas d’humanité sans limites