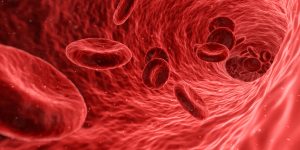Ce mercredi 2 février la Commission des affaires sociales s’est réunie à l’Assemblée nationale pour discuter de la proposition de loi d’Albane Gaillot (NI) visant à renforcer le « droit à l’avortement », rejetée le 19 janvier par le Sénat (cf. Les sénateurs, divisés, rejettent en bloc la proposition de loi Gaillot).
A l’issue de ce débat, quelques amendements ont été adoptés, mais rien de nouveau sur les principales questions : allongement du délai maintenu, double clause de conscience maintenue aussi malgré de nombreuses réticences (cf. La clause de conscience : seule rescapée de la « loi Gaillot »). Entre défense du « subtil équilibre » de la loi Veil et promotion démesurée du droit des femmes, ce débat a été l’occasion de mesurer la fracture idéologique au sein de l’Assemblée.
Peu de modifications du texte sur le fond
Les nouveautés du texte qui sera présenté en séance publique le 9 février prochain sont au nombre de deux.
La téléconsultation sera désormais ouverte pour toutes les consultations qui correspondent au parcours d’IVG médicamenteuse en ville (article 1er bis al 2), sur proposition de Cécile Muschotti (EC). Par ailleurs, un décret précisera les modalités d’organisation des nouvelles compétences des sages-femmes (article 1er bis al 4), à l’initiative de Marie-Noëlle Battistel (Rapporteure, PS) (cf. L’avortement : une priorité de fin de mandat ?).
Le refus du délai de réflexion
Bien qu’ils n’aient fait l’objet d’aucun changement, certains articles ont donné lieu à des débats, débutés déjà en séance publique lors des 1ère et 2ème lectures à l’Assemblée.
La suppression du délai de réflexion de 48h, malgré son adoption, a fait l’objet de nombreuses discussions. A la demande de certains (Thibault Bazin, LR et Valérie Six, UDI, Marie Tamarelle, LREM) de conserver le délai de réflexion de 48 heures après un entretien psycho-social, car il est indispensable et permet à la femme de s’extraire de certaines pressions, Albane Gaillot (NI) rétorque que les femmes « pourront attendre si elles veulent, mais il ne faut pas les infantiliser. Laissez la femme choisir ce qu’elle veut faire ! ». Elle est soutenue par Michèle Victory (PS), soulignant que les femmes « sont assez grandes pour choisir ».
Cependant, si tous se sont mis d’accord pour dire que c’est à la femme de choisir d’avorter ou non, la rupture au sein de la Commission des affaires sociales s’est faite sur la conception du délai : pour certains, c’est un délai protecteur (Thibault Bazin, LR), pour d’autres, c’est un vrai frein au « droit à l’avortement ». Supprimer le délai, c’est donc pour eux « permettre en toute sécurité à ces femmes de recourir à ce droit et à ce parcours de soin qui fera partie de la vie d’une femme sur 3 en France » (Cécile Muschotti EC).
Il semblerait donc qu’en adoptant cet article 1er Ter non modifié, on veuille laisser la femme seule dans sa décision, sans aucun temps de réflexion pour l’aider dans ce choix (cf. COVID-19 : Des femmes se tournent vers l’IVG pour des grossesses planifiées et désirées).
Clause de conscience spécifique : le symptôme d’une fracture idéologique
La clause de conscience spécifique à l’IVG ne fait, elle non plus, pas l’unanimité. C’est pourquoi, malgré son maintien dans le texte, certains députés, dont les rapporteures, ont souhaité revenir dessus.
En effet, ils estiment que cette clause spécifique est « stigmatisante ». Et qu’elle est « instrumentalisée » par les établissements de santé, ajoute Jean-Louis Touraine (LREM).
Au cours de ce débat, il est intéressant de voir comme la question autour de l’avortement se déplace du champ de l’éthique à celui du droit : « Il ne faut pas placer ce sujet dans une perspective éthique mais la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps » (Marie-Pierre Rixain, LREM). « Il faut être dans une vision plus moderniste de l’avortement » : tout est dit. Il y a bien une fracture entre ceux qui voient l’avortement comme un simple « droit » pour les femmes, et d’autres qui prennent aussi en compte l’enfant à naître, même assez implicitement ou intuitivement.
Mais puisque le droit français tend à faire de l’avortement un « droit des femmes », il est difficile de le restreindre, ou encore de l’encadrer. C’est là qu’émerge une contradiction, brillamment exposée par Geneviève Levy (LR) : « Il y a une ambiguïté dans ce qu’on vient d’entendre : on s’accorde pour dire que l’IVG est un acte traumatisant, pas anodin, qui va marquer la jeune fille qui y aura recours. […] Et en même temps par cet amendement on essaie de nous dire que l’IVG est un acte simple ; que la clause de conscience générale suffit parce que c’est comme tout autre acte chirurgical et médical. J’ai du mal à comprendre parce qu’on est d’accord sur les prémices : l’IVG n‘est pas un acte anodin, mais traumatisant. Mais on refuse de lui donner cet aspect particulier qui existe dans la double clause de conscience » (cf. Après l’IVG, des femmes témoignent).
C’est la raison pour laquelle Albane Gaillot, rapporteure du texte et fervente défenseuse du « droit à l’avortement », nie cette contradiction en revenant encore une fois sur son expérience personnelle, affirmant que son avortement s’était très bien passé et que « ce qui est traumatisant, c’est une grossesse non désirée ».
Pas de prévention, ni d’accompagnement
Il semblerait donc que le droit des femmes ne soit pas le véritable souci des députés, et qu’il s’agisse surtout là d’un combat idéologique qui vise à étendre l’avortement autant que possible. En effet, certains ont proposé d’inclure à l’article 2ter une évaluation sur l’accompagnement effectif des femmes qui souhaiteraient, après réflexion, poursuivre leur grossesse (Thibault Bazin, LR) ou encore d’insister sur le volet relatif à la prévention (Valérie Six, UDI). Pourtant, ces propositions intéressantes et conformes au droit des femmes, ont été rejetées par les rapporteures, sous prétexte que « ce n’est pas le sujet ». Pourtant, n’est-il pas question de droit des femmes ?