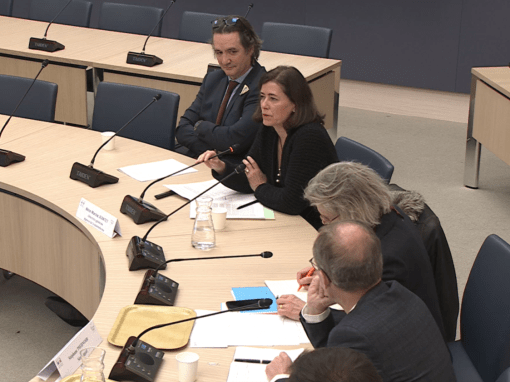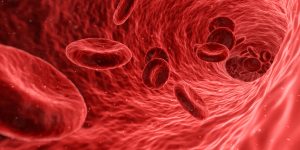Sans fondements éthiques solides, la loi de bioéthique s’apparente à une laborieuse construction artificielle qui peine à justifier ses transgressions.
« La bioéthique est un apprentissage contraint entre l’évolution des techniques et le respect de l’humain ». Frédéric Worms est philosophe et membre du Comité Consultatif national d’éthique. Il intervenait jeudi 7 octobre en introduction des journées de l’Agence de la biomédecine qui, cette année, font le point sur la loi de bioéthique du 2 août 2021. Dans son intervention, le philosophe a souhaité justifier les évolutions de la loi de bioéthique.
Pour lui, si la loi de bioéthique de 2021 « évolue », c’est pour dépasser des seuils à la fois politiques, historiques et juridiques, et accéder à des positions d’équilibre rendues « nécessaires » par les techniques elles-mêmes et par leur impact sur les relations. « Les techniques biomédicales entrent de plus en plus dans nos relations, explique-t-il, dans ce qui nous définit comme sujet, comme parent, comme enfant et dans les situations les plus critiques de ces relations. Les techniques évoluent et font bouger les enjeux ».
La loi de bioéthique pour dépasser les contradictions ?
Frédéric Worms souligne l’existence de contradictions inévitables. Il estime que « la bioéthique commence avec la découverte de contradiction entre la relation de soin comme relation première et d’autres relations humaines ». Pour le philosophe, il s’agit de « contradiction entre des relations éthiques ». Ensuite, « quand on veut soigner » il faut tenir compte d’une « double évolution », celle « des techniques médicales » et celle « des relations en tension, la relation de soin, la relation de dignité et aussi la relation de justice qui évoluent dans une société démocratique qui trouve dans son histoire de nouvelles injustices à réparer, des principes à respecter, des sujets libres et égaux ». Il ajoute que « le traitement de ces contradictions » utilise « les grands principes de la bioéthique », parmi lesquels : « ne pas nuire, respecter la liberté, respecter le consentement ». Et « l’histoire de la bioéthique consiste à trouver des arbitrages entre des techniques de plus en plus fines, et des relations de plus en plus complexes ».
Dans l’histoire de la bioéthique française, il s’est agi de « construire des catégories qui forment un équilibre solide, fondé sur le droit entre ces exigences contradictoires ». Frédéric Worms concède que « ces catégories ne sont pas des compromis faciles, ce sont des principes très clairs et très importants qui concilient les deux pôles opposés des relations morales : la relation de soin et la relation de justice, de reconnaissance mutuelle des libertés individuelles et de dignité personnelle dans une démocratie ». Une « construction (…) au cœur des lois de bioéthique ».
Une loi de bioéthique hors sol ?
Mais le droit est en perpétuelle évolution. La loi, remise sur le métier tous les cinq ans, ne peut pas servir de base pour modifier la société toute entière. En réalité, il n’existe plus de socle sur lequel appuyer une « morale » qui s’établit davantage en fonction de désirs individuels fondés sur l’affectif que sur la raison. On construit la loi en s’affranchissant de la loi naturelle qu’on convoque pourtant sans vergogne avec l’écologie pour les animaux, la terre, le climat, mais qui est complètement ignorée quand il s’agit de l’homme, du droit humain. On fait fi du réel pour s’embarquer dans des constructions intellectuelles. La nature ne manquera pas, tôt ou tard, de se rappeler à notre bon souvenir. La tension entre la technique et les relations, la justice ou l’injustice, pour justifier des transgressions majeures et modifier les fondements anthropologiques de la société semble bien pâles en regard des enjeux humains. Que deux femmes ne puissent procréer ensemble, s’agit-il vraiment d’une inégalité ? D’une inégalité à laquelle la société se doit de pallier ?
Frédéric Worms donne deux exemples. D’abord celui de l’accès aux données identifiantes pour les enfants nés d’une PMA avec don de gamètes, qu’il distingue de l’accès aux origines pour mieux séparer le « biologique » de la « filiation comme reconnaissance juridique qui définit le père ». Il reconnait que le don de gamètes n’est pas « un geste uniquement biologique » et comme tel impose un traitement spécial, « une évolution de plus en plus juste de la morale ». En vérité, est-ce qu’il ne s’agit pas simplement de rétablir un droit fondamental, celui de savoir qui est à l’origine de sa vie, de ses traits, de son caractère, de ses maladies ? De savoir simplement de qui vient son visage ?
L’introduction du projet parental dans l’article 1 de la loi, est selon lui la « grande nouveauté », qui permet de « justifier l’ouverture de la PMA aux couples de femmes ». En réalité, l’embryon est instrumentalisé et sa destinée est suspendue au désir de ses « parents ».
« Sans nuire à personne »
Le second exemple concerne les cellules souches : il n’y a plus « autorisation mais seulement déclaration de recherche » sur certains types de cellules souches, parmi lesquelles les cellules souches embryonnaires humaines. Comme le rappelle Frédéric Worms, elles sont capables de se différencier en toutes sortes de cellules pour donner, notamment, des gamètes humains, rappelant au passage qu’il n’y a pas de « droit à ce jour de faire des gamètes avec des cellules souches ». S’agirait-il alors de préparer les transgressions à venir ? Effectivement, avec des gamètes issus de cellules souches, la question des donneurs ne se posera plus. A quel prix ? Il estime enfin que la décision de passer d’un régime d’autorisation de recherche sur les cellules souches embryonnaires à un régime de déclaration simple s’apparente à une autorisation de soin « sans nuire à personne ». Sauf qu’en réalité, ces recherches se font au détriment de l’embryon… Que valent alors les principes de liberté ou de consentement établis à Nuremberg qu’il invoque ?