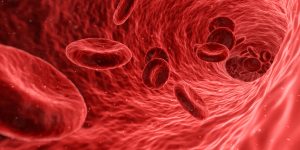En ouvrant aux infirmiers scolaires la possibilité de donner la pilule aux mineurs des collèges et lycées, sans prescription et gratuitement, le gouvernement suscite le malaise. Florence Taboulet, professeur de droit pharmaceutique et d’économie de la santé à l’Université de Toulouse III, relèvent les paradoxes et les ambigüités de cet élargissement.
Le décret d’application de la « loi de santé » de janvier 2016 tend à reproduire les modalités d’accès des médicaments de contraception d’urgence du circuit officinal aux infirmeries des établissements scolaires : sans prescription médicale[1], sans avis et sans suivi médical, sans traçabilité, à l’insu des parents, dans l’anonymat et dans la gratuité. La situation de malaise vécue par les pharmaciens face à des jeunes filles qui, bien souvent, revendiquent leur droit et refusent tout dialogue risque ainsi de s’étendre aux infirmiers scolaires.
Outre le constat d’échec en termes de santé publique – l’objectif poursuivi dès l’an 2000 par ce dispositif dérogatoire, la réduction des nombres de grossesses non désirées et d’IVG, n’est pas atteint -, cette délivrance à volonté a pour effet de banaliser ces médicaments. Or, la libéralisation de l’accès au produit a été accompagnée d’informations tronquées. Dès lors, l’autonomie offerte à la jeune fille peut difficilement être vécue de façon réfléchie et responsable.
Soulignons quelques-unes des incohérences et contradictions du système, tant en termes de sécurité sanitaire que de sécurité sociale.
- Comment justifier le principe ‘deux poids, deux mesures’ en vigueur au sein de la même classe thérapeutique ? En effet, la dose d’hormones sexuelles administrée en un jour avec la pilule du lendemain, en l’absence de toute intervention d’un médecin, est jusqu’à 50 fois plus élevée qu’une pilule ordinaire, qui est elle soumise à prescription pour des raisons de sécurité ?
- Comment peut-on se féliciter de « protéger notre jeunesse en matière de sexualité » alors que le dispositif déroge à la plupart des règles de prescription et de dispensation destinées à limiter l’accès au médicament ou sa durée d’utilisation pour en optimiser l’usage, et qu’aucune alternative n’a été introduite pour éviter les abus ? En effet, rien n’empêche la jeune fille de se procurer le médicament à répétition, au cours d’un même cycle menstruel ou au fil des mois, dans son collège ou son lycée, dans une même pharmacie ou dans plusieurs pharmacies, alors même que les mentions légales des produits stipulent que la contraception d’urgence ne doit être utilisée que de façon exceptionnelle. De fait, tout porte à penser que les utilisations en dehors du référentiel de l’AMM sont monnaie courante.
- Comment maintenir l’anonymat de la dispensation après l’affaire du Mediator® où il n’est question que de traçabilité, de surveillance post-commercialisation, d’étude pharmaco-épidémiologique d’utilisation et de chasse à toute utilisation hors AMM ?
- Pourquoi ne parle-t-on jamais du cycle féminin, alors que sa connaissance et sa maîtrise permettraient d’une part de conclure à l’inutilité de certaines prises, avec leur corollaire de risques, et d’autre part, de distinguer les modes d’action du produit en fonction de la période du cycle : contraceptive, lorsque le médicament est pris avant l’ovulation, interceptive, lorsque l’embryon est intercepté avant son implantation dans l’utérus, et contragestive, lorsque l’embryon, à peine implanté, est éliminé, ces deux derniers modes d’action correspondant à un avortement[2].
- Pourquoi prône-t-on de tous côtés une prise automatique, systématique et le plus rapidement possible après les rapports sexuels, sans rappeler que le produit ne prévient qu’entre 52% et 85% des grossesses attendues[3] ?
- Pourquoi le prix fixé par les pouvoirs publics du Norlevo® (6 ou 7 € le comprimé), à peine modifié depuis 15 ans, alors que le volume des ventes a explosé, est-il près de 100 fois plus élevé que celui de contraceptifs progestatifs à base du même principe actif, et le prix du milligramme, 3 à 4 fois plus élevé[4] ?
- Pourquoi EllaOne® peut-il bénéficier de la gratuité aux mineures alors que le prix, 19,70 €, est trois fois plus élevé que celui du Norlevo® tandis que sa supériorité affichée, sa plus longue durée d’utilisation, est très contestée[5] ?
- Est-il équitable d’exonérer ces prestations de tout ticket modérateur et de toute franchise au regard d’autres prestations destinées à lutter contre la maladie – le cœur des missions de l’Assurance maladie -, alors que ces prises de risque auraient pu être évitées par une meilleure information et des changements de comportement ?
- La gratuité constituant par nature une incitation à consommer, a-t-on mesuré l’incidence de l’offre généreuse de ces cadeaux sur la demande, c’est-à-dire sur les pratiques des jeunes filles, et notamment les comportements à risque ?
Cette politique, peu respectueuse de la protection de la santé des jeunes filles et sans doute contre-productive à de nombreux égards, devrait être complètement révisée pour qu’à l’autonomie soit réellement associée son corollaire, la responsabilité, à la fois personnelle, civique, écologique et collective.
[1] L’ordonnance a pour effet de promouvoir le bon usage, en limitant en quantité et dans le temps les prises de médicament.
[2] American College of Pediatricians. « Emergency Contraception – Not the Best for Adolescents ». February 2014. Disponible sur le site de American College of Pediatricians.
[3] Notice du Norlevo®.
[4] A partir du 1er janvier 2016, en incluant les honoraires de dispensation, les prix payés par l’assurance maladie sont les suivants : Norlevo® : 7,65 €, Lévonorgestrel Biogaran® : 6,32 €, Microval® (boîte de 28 comprimés) : 2,16 €, EllaOne® : 19,70 €.
[5] D’après la Revue Prescrire, pour une contraception d’urgence au-delà du 3ème jour et jusqu’au 5ème jour, EllaOne® « n’a pas une efficacité mieux démontrée que celle du lévonorgestrel » : « Contraception orale d’urgence : ulipristal disponible sans ordonnance » Revue Prescrire 2015 ; (381) ; 500 et « Ulipristal-Ellaone°. Contraception poslcoïtale : pas mieux que le lévonorgestrel », Revue Prescrire 2009 ; 29 (314) ; 886-889.