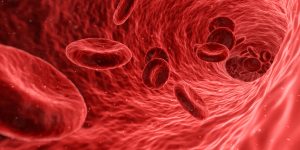Après des mois de navettes entre ses deux Assemblées, le Parlement français vient d’élargir les conditions du don d’organes en renforçant le consentement présumé, se passant désormais de l’avis des proches du défunt. Christophe Courage est avocat en droit de la santé. Il explique pour Gènéthique les conséquences et les enjeux de la loi adoptée le 26 janvier 2016.
Les principes encadrant le don d’organes post mortem
Le don d’organes post mortem consiste en un prélèvement d’organe sur une personne décédée. Il ne peut intervenir qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques, comme l’exige le Code de la Santé publique (article L 1232-1). Cette pratique, lorsqu’elle est strictement encadrée, est à encourager pour des raisons évidentes : elle permet à la médecine de sauver bien des vies. Le développement de la pratique du don d’organes dans des proportions supérieures aux pratiques actuelles permettrait ainsi d’éviter un grand nombre de décès chaque année.
La règlementation encadrant le don d’organes s’inspire du principe selon lequel le corps humain est hors commerce : selon l’article 16-1 du Code civil issu de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, le corps humain est « inviolable », et ne peut, ainsi que ses éléments et ses produits, « faire l’objet d’un droit patrimonial ». Ce principe ne disparaît pas avec le décès de la personne concernée.
Ces principes, ainsi que les risques liés à une marchandisation du corps humain, dont le stade ultime est tout simplement l’esclavage ou, au cas particulier, le trafic illicite d’organes, ont conduit le législateur à soumettre les dons d’organes, même post-mortem, à des conditions strictes.
Les modifications apportées par la loi du 26 janvier 2016
Avant l’intervention de la dernière loi santé, le Code de la Santé publique permettait d’une manière générale de pratiquer un prélèvement d’organes sur toute personne n’ayant pas fait connaître, de son vivant, le refus d’un tel prélèvement.
Dès 2000, le principe était posé selon lequel le refus, révocable à tout moment, pouvait être exprimé par l’indication de la volonté du défunt sur un registre national automatisé, ou, après la mort, exprimé par le témoignage de la famille du défunt.
La loi du 6 août 2004 a précisé que le médecin, s’il n’a pas connaissance de la volonté du défunt, devait s’efforcer recueillir par tout moyen les preuves de la volonté du défunt, non seulement auprès de la famille mais aussi auprès des proches, lesquels doivent être informés de la finalité des prélèvements envisagés et de leur droit à connaître les prélèvements effectués.
En revanche, la loi du 26 janvier 2016 a supprimé du Code de la Santé publique l’obligation faite au médecin de rechercher auprès des proches du défunt sa volonté de donner ou non ses organes. C’est donc toute une construction législative élaborée depuis l’an 2000 qui a été remise en cause. Dès que cette disposition nouvelle entrera en vigueur, soit le 1er janvier 2017, le médecin sera donc dispensé de son obligation de recherche de la volonté du défunt. En revanche, le principe selon lequel il est possible d’apporter la preuve, même par témoignage, de l’expression d’une volonté hostile au don d’organe, ne disparaît pas de la loi. Il est maintenant précisé que le refus peut s’exprimer « principalement » par l’inscription au registre national automatisé, ce qui laisse la porte ouverte à d’autres expressions du refus.
Enjeux et conséquences de la réforme
L’expression du consentement, en droit civil, écarte en général la présomption : le consentement doit faire l’objet d’une formulation expresse. Le droit médical va encore plus loin et l’article L 1111-4 du Code de la Santé publique pose le principe selon lequel « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ».
La question du don d’organe pose un dilemme car, in fine, est en jeu la vie du malade qui attend un donneur. Le législateur a choisi, avec la loi du 26 janvier 2016, de renforcer les prérogatives dérogatoires au droit civil et à la déontologie médicale données aux autorités sanitaires. Le principe du consentement présumé était déjà en soi discutable, mais il était, avant la loi du 26 janvier 2016, tempéré par l’obligation d’investigation mise à la charge du médecin.
Manifestement, la nouvelle loi est allée trop loin dans les prérogatives données au médecin en matière de prélèvement d’organes. Deux risques se profilent. Le premier est relatif à la relation entre le médecin, chargé du prélèvement d’organes, et la famille du défunt. L’application des nouvelles dispositions laisse en effet la famille de côté et risque de créer conflits et incompréhensions dans le moment nécessairement douloureux de la perte d’un proche. De surcroît, les organes les plus utiles à la médecine sont ceux de personnes jeunes, donc de défunts partis trop tôt.
Le second risque est relatif à l’inviolabilité du corps humain. Le corps des défunts risque maintenant de devenir une sorte de réserve d’organes dont il sera possible de disposer à loisir, si le défunt hostile au don de ses organes et mal informé des possibilités données aux autorités sanitaires par la loi, n’a pas exprimé de refus de son vivant.
Il existait pourtant d’autres solutions plutôt que ce passage en force. Pour que le don d’organes reste réellement un don, il est nécessaire que le défunt ait exprimé un consentement exprès. Il est parfaitement possible, par des campagnes d’information, d’exposer à tous l’utilité et la générosité d’un tel geste. Il est également possible, à l’arrivée de chaque citoyen à l’âge adulte, que l’administration demande à chaque citoyen d’exprimer sa position, en toute liberté, dans un sens ou dans un autre. De telles mesures auraient évité d’adopter les dispositions de la loi du 26 janvier 2016, un remède qui risque d’apparaître, à l’usage, pire que le mal.