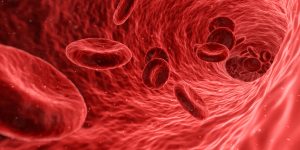Le 6 mai dernier, le Conseil d’Etat (CE) a rendu public son rapport sur la prochaine révision de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Voici ses principales recommandations.
Autoriser la recherche sur l’embryon
Dans un premier temps, le CE rappelle que l’embryon humain est “une vie humaine potentielle et non une chose”, qu’”il ne peut être traité comme un simple matériau de recherche” et qu’”on ne peut par principe lui porter atteinte que pour des raisons majeures et dûment justifiées“. Il qualifie même la recherche sur l’embryon de “transgression” au “principe supérieur” de “protection de l’embryon” ; celle-ci n’étant admissible “que pour des fins thérapeutiques bien définies et particulièrement importantes du point de vue collectif“.
Et pourtant, tout en reconnaissant que conserver l’actuel régime d’interdiction de la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines assorti de dérogation présenterait l’avantage de maintenir l’affichage d’un interdit symbolique fort, il propose d’adopter un régime permanent d’autorisation “enserré dans des conditions strictes“. Ainsi préconise-t-il, pour l’article L. 2151-5, la rédaction suivante : “Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :
– la pertinence scientifique de la recherche est établie,
– la recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs,
– il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche identique à l’aide d’autres cellules que des cellules souches embryonnaires humaines,
– les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques“.
Pour justifier sa position, le CE évoque, d’une part, un souci de “cohérence” selon lequel “le législateur ne pourrait raisonnablement poser une interdiction et édicter dans le même temps, à titre permanent, une dérogation dont l’effet serait en pratique de vider de son sens cette interdiction“, et, d’autre part, le fait que 95% des projets de recherche soumis à autorisation ont été retenus par l’Agence de la biomédecine.
Professeur de droit public à Paris-I, Bertrand Mathieu critique ce changement de régime prôné par le CE, affirmant que les questions de bioéthique ont besoin de stabilité juridique. Inverser la situation et ériger en principe l’actuelle dérogation nous fait entrer, au contraire, dans “une situation d’incohérence juridique préjudiciable“.
DPN : “impératif éthique” et choix de “santé publique“
Dans sa lettre de saisine du 11 février 2008, le Premier ministre, François Fillon, faisait part de sa préoccupation quant aux éventuelles dérives eugénistes et demandait, en premier lieu, au CE de répondre à la question suivante : “les dispositions encadrant les activités d’assistance médicale à la procréation [AMP] et, en particulier, celles de diagnostic prénatal [DPN] et de diagnostic préimplantatoire [DPI], garantissent-elles une application effective du principe prohibant “toute pratique eugénique tendant à l’organisation et à la sélection des personnes” ?“. Définissant l’eugénisme comme “l’ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine“, la Haute juridiction admet que l’eugénisme peut être, outre “le fruit d’une politique délibérément menée par un Etat“, “le résultat collectif d’une somme de décisions individuelles convergentes“. Il cite ainsi le cas de la trisomie 21 : “en France, 92% des cas de trisomie sont détectés, contre 70% en moyenne européenne, et 96% des cas ainsi détectés donnent lieu à une interruption de grossesse, ce qui traduit une pratique individuelle d’élimination presque systématique des fœtus porteurs“. Et pourtant, il lui paraît “illusoire et même injustifié d’empêcher ou de retarder l’accès à des techniques de dépistage : l’accès à l’analyse des marqueurs sériques dès le premier trimestre” et ce, au nom d’un “impératif éthique à l’égard des femmes enceintes – leur donner la possibilité de choix moins tardifs” et de “considérations de santé publique – limiter le nombre de fausses couches liées à l’amniocentèse“.
Un arrêté, actuellement soumis au ministre de la Santé, propose en effet d’avancer les examens de dépistage de la trisomie 21, aujourd’hui réalisés au deuxième trimestre de grossesse, au premier trimestre1. Un tel dispositif n’en resterait pas moins un calcul de risque avec ses faux négatifs (enfant trisomique non dépisté) et ses faux positifs (enfant non atteint dépisté à tort). Et, si le risque s’avérait élevé, il faudrait quand même procéder à la confirmation diagnostique par un prélèvement. L’amniocentèse étant impraticable à ce stade de la grossesse, il faudrait se tourner vers la biopsie de trophoblaste (futur placenta) qui induit un taux de pertes fœtales 1,5 à 2 fois plus élevé qu’avec l’amniocentèse, cette-dernière entraînant une fausse couche dans 0,5 à 1% des cas. Les femmes, à qui l’on veut par cette mesure éviter toute angoisse, devront donc choisir entre une biopsie de trophoblaste, plus tôt mais plus risquée et une amniocentèse, plus tardive mais moins risquée. De plus, la volonté affichée de disposer des résultats en 48 heures ne se heurte-t-elle pas au consentement libre et éclairé que requiert la loi ?2
En bref, le groupe de travail du CE, présidé par Philippe Bas, reconnaît l’existence de pratiques eugéniques en France tout en en encourageant la mise en œuvre… Concrètement, la seule solution qu’il propose pour limiter les risques de dérives eugéniques est l’information et l’accompagnement des femmes.
Elargir l’accès au DPI ?
Dans le cas du DPI, le CE estime que la notion de “particulière gravité” nécessaire pour un recours au DPI laisse “une marge suffisante d’interprétation“, quitte à ce que le DPI soit utilisé pour la recherche de prédispositions à certaines maladies à révélation tardive (cf. Lettre n°109). Il ne recommande pas l’établissement d’une liste de maladies ouvrant “droit” au DPI, mais juge en revanche nécessaire “d’augmenter les moyens humains et financiers” afin de “réduire sensiblement” le délai d’attente (entre 18 et 24 mois) pour obtenir un DPI. Le CE évoque par ailleurs “la différence d’encadrement législatif” entre DPI et DPN qui “empêche de détecter certaines affections dans le cadre du DPI, avant le transfert in utero (…), mais permet d’y procéder après, dans le cadre d’un DPN, alors que la grossesse est en cours“. N’évoque-t-il pas ici, en creux, la possibilité d’élargir l’accès au DPI à toutes les dispositions pour lesquelles le DPN est accessible et ce, alors qu’il reconnaît que “tout assouplissement du DPI induit des risques supplémentaires d’eugénisme” ?
Enfin, en ce qui concerne le “double DPI” ou DPI-HLA, plus couramment appelé “bébé médicament”, le CE précise que “les questions éthiques (…) et le fait qu’il ait été peu utilisé pourraient justifier que le législateur envisage de mettre un terme à cette pratique“. Il propose donc de proroger cette pratique, tout en en envisageant une évaluation approfondie dans cinq ans.
AMP, don de gamètes et GPA
Le CE préconise de ne pas modifier les conditions d’accès à l’AMP prévues par la loi de 2004 et écarte donc la possibilité pour les femmes seules et homosexuelles de recourir à l’AMP. Il ne semble pas non plus vouloir revenir sur l’exigence de vie commune d’au moins deux ans. Le CE affirme par ailleurs son opposition au transfert d’embryon post-mortem.
Sans revenir sur le principe de gratuité du don de gamètes (tout en souhaitant en neutraliser le coût financier pour le donneur), il se prononce en faveur d’une levée partielle de l’anonymat (accès à certaines données non identifiantes et possibilité d’une levée de l’anonymat si l’enfant le demande et si le donneur y consent).
Le CE justifie ensuite la possibilité d’accueil d’embryons au motif que celle-ci “assure au plan symbolique que tout embryon surnuméraire n’est pas voué, soit à la destruction, soit à la recherche“.
Concernant la gestation pour autrui (GPA), il estime justifiée l’interdiction actuelle mais propose quelques “solutions ponctuelles” (transcription de la filiation paternelle et délégation avec partage de l’autorité parentale pour la mère dite d’intention) pour “pallier les difficultés pratiques” des familles qui ont eu recours à la GPA, “sans modifier les règles relatives à la filiation“.
Loi-cadre
En conclusion, la plus haute juridiction administrative française recommande au législateur de ne pas renouveler l’obligation de réexamen de la loi tous les cinq ans. D’une part, avance-t-elle, il ne s’agit plus de poser de nouveaux principes mais de mettre en œuvre ceux existants et, d’autre part, une “surréglementation (…) ferait dans certains domaines obstacles au bon déroulement de la recherche ou du soin“. Le CE propose donc au législateur de s’appuyer sur le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine ainsi que sur le Conseil d’Etat et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) auxquels il pourrait demander une réflexion régulière sur la loi de bioéthique.
1- Cf. la tribune de Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune et auteur de La trisomie est une tragédie grecque (Ed. Salvator, 2009), parue dans Le Figaro du 9 mai 2009 : Les risques d’un dépistage à outrance de la trisomie 21.
2– L’étude de l’Inserm Prenatal screening for Down syndrome: women’s involvement in decision-making and their attitudes to screening (Valerie Seror, Yves Ville, 2009) a déjà montré que “la moitié des femmes qui ont accepté une échographie et un test sanguin n’avaient pas conscience qu’elles pourraient être amenées à prendre d’autres décisions : faire ou non une amniocentèse et, en cas de diagnostic avéré de trisomie 21, poursuivre ou interrompre leur grossesse“.