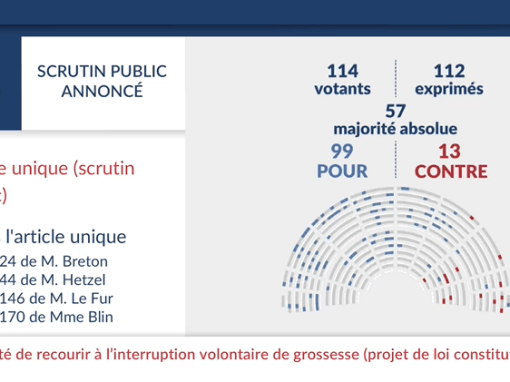Dénaturée année après année, la loi Veil, qui a dépénalisé d’avortement en France, est souvent considérée comme un moindre mal. Mais peut-elle y prétendre ? Pascal Jacob, philosophe et expert, fait le point pour Gènéthique.
Le décès de Simone Veil a été l’occasion de constater qu’un long chemin avait été parcouru depuis la promulgation de la loi qui porte son nom. Triste épitaphe. Conçue comme la dépénalisation d’un délit, la loi Veil a été assez vite revendiquée comme un droit fondamental, celui pour la femme de disposer de son corps.
Le terme même d’interruption volontaire de grossesse aurait déjà dû alerter. Est-ce vraiment le problème ? Toute grossesse n’est-elle pas vouée à s’interrompre au moment de l’accouchement ? La vraie question ne se situe-t-elle pas plutôt du côté de ce qui est fait pour l’interrompre ? Ne pas nommer correctement l’acte en jeu est déjà une façon d’empêcher d’en mesurer la nature.
L’argument du nombre d’avortements clandestins et de la mortalité qui lui est attachée mériterait également d’être examiné avec rigueur. Car s’il est par définition difficile d’évaluer le nombre d’avortements clandestins, donc dissimulés, il est, en toute rigueur, aussi malaisé d’estimer les décès qui y sont liés.
Le sophisme de la loi Veil
La loi Veil avait été présentée comme une sorte de moindre mal, abusant de l’argument du « il vaut mieux » : il vaut mieux un avortement règlementé en milieu sanitaire qu’un avortement clandestin où la femme risque de laisser la vie. Cet argument est souvent un sophisme, parce qu’il consiste à comparer deux choses qui diffèrent de plusieurs façons, en s’appuyant sur la différence qui ne pose pas de problème, pour emporter l’adhésion. Si l’on refuse le manque d’hygiène de l’avortement clandestin, alors on doit accepter l’avortement encadré par la loi, mais on esquive ce qui pose réellement problème, à savoir l’avortement. Il s’agit d’un sophisme, car c’est un peu comme si l’on disait qu’il vaut mieux être assassiné sans torture qu’avec torture pour faire admettre l’assassinat en s’appuyant sur le rejet de la torture.
L’argument du moindre mal ne peut fonctionner que dans le cadre de ce qu’il convient d’appeler la tolérance. Non pas la tolérance au sens relativiste que ce mot a pris et qui signifie davantage une indifférence. La vraie tolérance est une patience : on supporte une chose mauvaise parce qu’on ne peut l’éviter sans commettre un mal plus grand, et parce que l’on peut raisonnablement espérer que cette patience produise un bien. Ainsi, il vaut mieux laisser un enfant fumer un peu, si l’on peut raisonnablement craindre qu’en l’empêchant de fumer, il décide de fuguer, et si l’on peut espérer que cette patience permette de conserver le dialogue. Cela ne fait pas de l’acte de fumer un droit fondamental.
Pour le politique, cet argument peut signifier qu’entre deux mauvaises décisions, il faut choisir la moins mauvaise. Poursuivre la guerre en 1940, c’est prendre le risque d’une défaite encore plus lourde. Accepter l’armistice, c’est livrer le pays à un occupant liberticide. Si chacune de ces deux solutions paraissent mauvaises, il est raisonnable de choisir la moins mauvaise.
Le problème de la loi Veil est qu’elle est foncièrement mauvaise, et ce pour plusieurs raisons.
Maîtriser la reproduction humaine
La première lui est presque accidentelle, à savoir l’intention qui la sous-tend. Cette intention a été explicitée par Pierre Simon[1] dans La vie avant toute chose, paru en 1979. Ce gynécologue, membre du cabinet de Simone Veil et de la Grande Loge de France, disciple de Margaret Sanger qui fut la très eugéniste fondatrice du planning familial américain, y expose candidement qu’il est temps pour la société de prendre en charge la reproduction des hommes trop longtemps laissée à la seule régulation des familles, afin de la rationnaliser. Pierre Simon montre comment l’avortement est une étape nécessaire pour que les hommes arrachent à Dieu la maîtrise de la vie :
« La vie est ce que les vivants en font. Les vivants sont les véhicules de la vie. La vie existe toujours par un réseau de relations qui déterminent l’existence des humains. (…) La vie n’est pas en soi. J’ai cité l’exemple bien connu des Esquimaux qui pratiquent – occasionnellement – l’infanticide lorsque la nécessité s’impose. Cet exemple, qui nous révolte, montre que l’enfant n’est finalement reconnu homme que par celui qui l’a engendré : c’est la société qui le porte dans son sein. »
« C’est pourquoi, en matière d’avortement, il nous a semblé utile de renvoyer l’homme à sa propre responsabilité, et non pas à une entité réfléchie par le miroir du divin »[2].
Une remise en cause des fondements de la loi
La seconde raison est que la loi Veil s’attaque à un principe extrêmement fondamental, qui fonde la légitimité de toute loi. Car la loi n’est légitime que parce qu’elle réalise la justice, qui consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. Or, exister est la condition sans laquelle nul ne peut recevoir ce qui lui est dû. C’est pourquoi la protection de la vie de l’innocent est la raison d’être de la loi, le principe qui lui donne toute capacité d’obliger la conscience et toute capacité de faire justice. La loi qui tue est la négation même de la justice, car il n’y a pas de justice possible envers celui qu’on a tué.
On objectera sans doute que l’embryon n’est pas humain, ou qu’il n’est pas une personne. Je n’entrerai pas ici dans ce débat, parce que le motif de la loi Veil est précisément la reconnaissance que l’embryon est un être humain. Cela ne doit pas nous étonner : si la loi considérait l’embryon au même titre qu’une molaire, la loi Veil n’existerait pas. Mais l’analyse de son article premier est édifiante :
« La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. »
Quel est le principe invoqué ? « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». Dire que la loi pose des conditions à la transgression de ce principe, c’est reconnaître à l’embryon concerné le statut d’être humain, qu’il le soit véritablement ou pas.
Ce qui est ici extrêmement grave, c’est que la loi Veil pose un principe qui est, au fond, le principe premier du droit : la nécessité de respecter la vie de l’être humain. Puis, par la magie d’une incroyable pirouette, elle se prétend au-dessus de ce principe qu’elle reconnaissait quelques mots avant, avoir mission de garantir. C’est donc la loi qui devient le principe du droit : j’ai des droits parce que la loi m’en donne. Or parler de justice signifie que quelque chose m’est dû, avant toute loi, et que la loi n’est écrite que pour exprimer l’obligation qui s’impose à tous de ne pas me priver de ce qui m’est dû. Ainsi, c’est parce qu’il est dû au piéton de ne pas porter atteinte à son droit de vivre que la loi commande de lui laisser le passage. Ce n’est donc pas la loi qui invente le droit, mais c’est à elle de « dire » le droit qui est celui de chacun, en raison par exemple de son statut d’être humain, fut-il embryonnaire.
L’élément subjectif
Une troisième raison pour laquelle cette loi est profondément mauvaise, c’est qu’elle a placé la subjectivité au principe du droit en son Titre 2 : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». La détresse est un élément éminemment subjectif, et donc irréfutable. En faisant reposer le droit sur le sentiment subjectif et non sur des circonstances objectives, le législateur a ouvert une brèche extrêmement grave dans le droit. Au nom du droit de ne pas souffrir, de ne pas être malheureux, on asservit le droit et, au passage, la médecine, à la volonté de l’individu.
Enfin, une raison qui n’est pas la moindre de considérer cette loi comme mauvaise est qu’elle affaiblit le respect que nous avons pour nos semblables, et en particulier pour les plus fragiles d’entre eux. L’article 5 crée un droit à l’avortement thérapeutique « à tout moment », en particulier pour les enfants handicapés. Il n’est pas difficile d’apercevoir que le respect de celui qui vit est la condition fondamentale de tout autre respect, parce que le fait de vivre est lui-même la condition de tout ce pour quoi nous mériterions d’être respecté. L’évolution que nous avons connue depuis la loi Veil en est la preuve manifeste. Tandis que Simone Veil admettait que l’avortement était toujours un échec, ses enfants spirituels veulent le faire reconnaître comme un droit fondamental. Mais cette évolution n’était-elle pas inéluctable, dès lors que la loi sape le principe même de toute loi, qui est l’attention à celui qui vit ?
On ne peut pas invoquer l’argument du moindre mal dès lors que ce mal n’est pas moindre. L’avortement est sans doute l’un des pires maux, parce qu’il obscurcit le sens que nous avons de la dignité de tout être humain dès sa conception. En refusant à l’homme embryonnaire la dignité qui lui revient, en la faisant dépendre du regard des autres ou de la décision juridique, le législateur a outrepassé ses droits et fragilisé à jamais notre responsabilité envers autrui, c’est-à-dire le fondement éthique de toute loi et de toute vie sociale en général.
Quand la volonté fait défaut
Tout cela est bien beau, rétorquera-t-on, mais que pouvait-on faire ?
Ce ne sont pas les moyens qui ont fait défaut mais la volonté, comme la lecture de Pierre Simon le montre.
Les « enfants de 68 » ont fait de la sexualité une activité tournée simplement vers la recherche d’une satisfaction. Il était inévitable que l’enfant devienne un indésirable dont il fallait se débarrasser. Placée sous le signe de l’émancipation et non de la responsabilité, la sexualité se voit privée de l’une de ses dimensions fondamentales : à savoir la possibilité pour chacun d’être père ou mère. Mais les « enfants de 68 » voulaient peut-être qu’il n’y ait plus de pères, ni de mères, mais seulement des adolescents qui se contentent de « vivre des expériences ».
La loi Veil est sans doute l’une des premières expressions de cette irresponsabilité revendiquée, par laquelle la sexualité est privée de ce qui lui donne pourtant son sens véritablement humain. Mais cette exigence d’irresponsabilité a rencontré une volonté beaucoup plus sournoise, dont Pierre Simon s’est fait l’écho, une volonté politique de séparer la sexualité de sa fécondité, de manière à ce que la fécondité obéisse de façon plus rigoureuse aux exigences de la société.
Ainsi le sexe pulsionnel, libéré de la différence sexuelle, efface le sexe responsable, celui qui s’inscrit dans la différence sexuelle et assume une fécondité possible. L’individu abandonné à ses pulsions abandonne à son tour sa responsabilité de père ou de mère à l’Etat, annonçant la troublante prophétie de Tocqueville :
« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent point; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? »[3].
L’évolution de la loi Veil semble témoigner dès l’origine de son caractère mauvais. Une fois la volonté du législateur placé au-dessus du principe premier de toute loi, qui est le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, tout le droit se trouve renversé par une lame de fond dont l’effet est la confusion entre « je veux » et « j’ai le droit », qui n’est rien de moins que l’abolition du droit.
Pour aller plus loin :
Décryptage de la loi Veil : les arguments en débat
40 ans après la loi Veil, un «droit fondamental à l’IVG » ? [Décryptage 1]
40 ans après la loi Veil, un «droit fondamental à l’IVG » ? Des juristes réagissent [Décryptage 2]