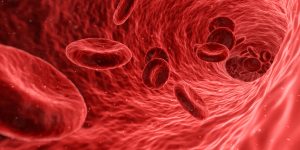Gènéthique se fait l’écho d’une étude de Jocelyn Clerckx[1], Maître de conférences HDR en droit public à la Faculté des Affaires internationales du Havre, sur la marchandisation de l’embryon humain. Une menace actuelle que différentes législations promeuvent pas à pas, au service des intérêts de l’industrie pharmaceutique.
Aujourd’hui, les principes du droit et les lois ayant placé l’embryon humain « hors commerce », il semble « protégé de toute forme de marchandisation ». La réalité est plus complexe dans un contexte où la « tendance à tirer un profit mercantile d’une activité non marchande » est bel et bien présente.
Depuis 11 ans, il est possible d’utiliser les embryons issus de PMA, de façon encadrée, pour la recherche. Ces recherches sont « contestables sur un plan éthique » puisqu’il s’agit « d’expérimentations destructrices de l’embryon qui aboutissent à sa réification totale ». Il n’est plus utilisé que « comme un matériau de laboratoire dont la valeur se limite à ses propriétés biologiques ». Cependant, cette recherche fondamentale, effectuée dans un cadre public, laissait espérer qu’elle « serait à l’abri des lois du marché ». Mais, les liens entre les laboratoires académiques et les firmes industrielles s’étant intensifiées, la recherche s’est calquée sur les lois du marché de la société libérale.
Par ailleurs, pour rattraper son « retard » en matière de publication, « le gouvernement a, en 2012-2013, activement soutenu une initiative parlementaire tendant à renverser les principes régissant la recherche sur l’embryon humain qui avaient été mis en place par la loi bioéthique du 7 juillet 2011 ». La nouvelle loi bioéthique du 16 juillet 2013 « a supprimé l’interdiction de principe de la recherche sur l’embryon » et a « créé un régime d’autorisation assoupli ». Ces modifications législatives, accueillies avec enthousiasme par l’industrie pharmaceutique, « ont fait naître un risque certain d’instrumentalisation de l’embryon humain à des fins plus ou moins directement marchandes ».
Un régime dérogatoire modifié par la loi de juillet 2013
Le principe d’interdiction de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires avec un régime dérogatoire prévu par la loi bioéthique de 2011 a été supprimé par la loi de juillet 2013, au profit d’un régime d’autorisation assoupli, qui bouleverse le cadre légal établi.
- Désormais, « les autorisations n’ont plus à êtres motivées ». Seules les décisions de refus de l’Agence de biomédecine, concernant ces recherches, devront l’être.
- Par ailleurs, les projets de recherche ne doivent plus exclusivement relever de la recherche fondamentale qui vise à « acquérir de nouvelles connaissances sans envisager d’application particulière ». Elle peut concerner aussi la recherche appliquée qui est elle « dirigée vers un objectif pratique déterminé ». C’est le type de recherche souvent réalisées par « les laboratoires privés de l’industrie pharmaceutique ».
- Il n’est plus exigé que ces recherches servent des progrès médicaux majeurs, mais une finalité médicale, une recherche à « ‘coloration’ médicale », qui peut aussi inclure, par exemple, la cosmétologie !
- Enfin, le chercheur n’a plus à prouver qu’il n’a pas d’autres moyens que la recherche sur l’embryon humain. Il lui suffit désormais d’établir qu’ « en l’état des connaissances scientifiques », il a besoin de cette recherche.
La loi devait permettre de remédier au manque d’attractivité de la France et au retard accumulé par l’industrie pharmaceutique dans ces domaines, comme l’a souligné Madame Orliac, députée et rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée. Une « préoccupation qui témoigne de l’emprise de la doxa libérale sur la question de l’embryon ».
Des applications pratiques qui servent les intérêts industriels et commerciaux immédiats de l’industrie pharmaceutique
Pourtant, la découverte du professeur Yamanaka sur les IPS a réduit l’intérêt de la recherche sur ces cellules souches embryonnaires, d’autant plus qu’à ce jour, « aucun progrès significatif sur le plan thérapeutique n’a pour l’instant découlé des recherches sur ces cellules embryonnaires ».
La persistance du recours aux cellules souches embryonnaires n’a pas pour objet des fins thérapeutiques qui semblent aujourd’hui lointaines et aléatoires. D’autres applications sont possibles « dans l’immédiat » et notamment celles qui visent à « utiliser l’embryon humain et ses cellules souches afin de concevoir et de tester des médicaments destinés à être commercialisés ». La tentation est d’autant plus forte en France que, par un « effet d’aubaine », la réserve d’embryons humains sans projet parental est importante et permet d’économiser l’étape de la recherche sur l’animal, longue et coûteuse. L’argument est « donc essentiellement économique ».
Pour ces raisons, le législateur a « complaisamment » facilité les expérimentations sur l’embryon humain, qui n’« étaient pas indispensables sur le plan médical ». Le seul obstacle qui semble demeurer est celui de la non-brevetabilité de l’utilisation de l’embryon humain à des fins industrielles et commerciales, mais ce principe est également fragilisé.
L’embryon humain n’est pas brevetable
En effet, la Cour de Justice Européenne, par la directive de juillet 1998, exclut l’embryon humain des utilisations industrielles et commerciales. La directive s’applique strictement au code français de la propriété intellectuelle.
L’arrêt Brüstle du 18 novembre 2011 confirme que l’embryon n’est pas brevetable en raison du « respect dû à la dignité humaine » qui « pourrait en être affecté » ; elle énonce que l’ovule constitue un embryon dès sa fécondation dès lors qu’elle est « de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ». De cette façon, la « Cour anéantit la thèse selon laquelle l’embryon n’existerait pas, à proprement parler, dès la conception ». L’arrêt exclut donc aussi la brevetabilité des embryons obtenus par clonage ou parthénogénèse (cf. Les parthénotes humains, source controversée de cellules souches). « Cette définition inclusive de l’embryon humain s’accompagne d’une interprétation extensive de l’interdiction de l’utilisation à des fins industrielles et commerciales » qui s’ajoutent aux restrictions pour fins de recherche. Et il suffit qu’une utilisation ou une destruction d’un embryon ait eu lieu « en amont d’une invention pour que cette dernière ne soit pas brevetable ».
La seule exception, contestable sur le plan éthique, concerne une utilisation ayant « un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles ». Malgré tout, la jurisprudence européenne empêche l’industrie pharmaceutique d’aller au bout de ses projets de brevetabilité des recherches sur l’embryon humain.
Le rempart de la non-brevetabilité de l’embryon humain fragilisé
La fragilisation du principe de non-brevetabilité date de décembre 2014 (cf. CJUE : les ovules humains « activés » sont-ils des embryons ? et l’« activation » des ovocytes pose des questions éthiques). La CJUE est revenue sur sa jurisprudence Brüstle au sujet des parthénotes[2], en changeant de critère. Le parthénote, au sens de l’arrêt Brüstle, était un embryon dès lors qu’il était « de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain (…) ». Dans le nouvel arrêt, un embryon « doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain », c’est-à-dire, être « capable d’aboutir à un tel ‘être humain’ ». Ce qui n’est pas le cas des parthénotes « qui ne se développe pas au-delà du stade du ‘blastocyste’ ». Du moins, dans l’état des connaissances actuelles de la science. En conséquence, « la brevetabilité de l’utilisation d’un ‘parthénote’ à des fins industrielles ou commerciales n’est plus prohibée ».
Une analyse qui a de quoi inquiéter. Si le parthénote peut, en effet, se développer au stade d’un embryon de 5 jours, dont on peut obtenir des cellules souches embryonnaires, c’est qu’il possède toutes les propriétés biologiques de l’embryon… Une posture d’autant plus contestable, qu’elle revient à autoriser « l’utilisation d’embryons créés à des fins d’exploitation par clonage »[3].
Et en France ?
En France, le parthénote n’a pas été qualifié d’embryon humain lors de l’affaire International Stem Celle Corporation… Avec cette nouvelle position, le « parthenote » échappe « à l’interdiction du clonage et son utilisation à des fins industrielles et commerciales ». Il « peut être brevetée sans problème ». Par ailleurs, l’arrêt ne rappelle pas que l’exclusion de brevetabilité de la recherche sur l’embryon porte aussi sur l’utilisation à des fins de recherche scientifique.
Si la CJUE[4] confirme cette interprétation, l’approche anglo-saxonne l’emporterait, validant un alignement progressif sur le moins disant éthique au plus international, pour des raisons économiques : « Plus rien n’empêcherait en France l’industrie pharmaceutique de se saisir de cet embryon pour breveter des procédés utilisant ses cellules afin de développer et tester des médicaments en vue de leur commercialisation ». « Il y a bien un risque avéré de marchandisation de l’embryon. »
Mais il se pourrait que la science elle-même fasse barrage à cette évolution juridique. Même si les cellules souches embryonnaires offrent encore des perspectives juteuses en vue de l’élaboration de médicaments, la recherche sur les cellules IPS semble, à terme, bien plus prometteuse (cf. La recherche biomédicale et la médecine clinique qui en est le résultat progressent sans faire appel à l’embryon humain).
[1] J. CLERCKX, Vers la marchandisation de l’embryon humain ? A propos de quelques développements récents en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires, à paraître in F. BOTTINI, L’influence du néolibéralisme anglo-saxon sur le droit public Français, Faculté des Affaires internationales du Havre, colloque des 12-13 novembre 2015.
[2] Parthénote : Individu obtenu par parthénogénèse (la reproduction sans fécondation (sans mâle) dans une espèce sexuée). L’ovule n’est pas fécondé, mais stimulé. Le parthénote se développe jusqu’au stade bastocyste.
[3] La parthénogénèse constitue bien un type particulier de clonage à partir d’un ovule, dès lors que « l’ovocyte [qui en résulte] contient seulement de l’ADN maternel ».
[4] Cour de Justice de l’Union Européenne.