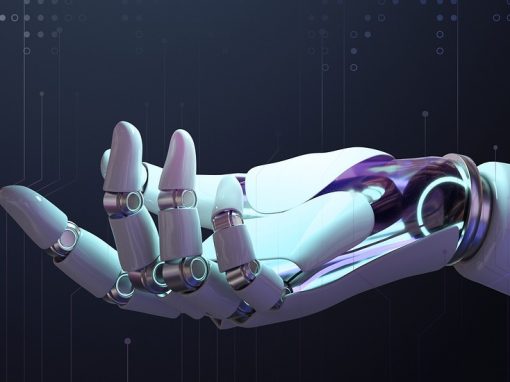L’idée d’un « transhumain » dominant les contingences de son état naturel, n’est, à y réfléchir, pas si futuriste. Augmentation, réparation, la limite est en effet ténue et confuse ; elle n’est pas sans remettre en question la pratique médicale, la recherche… Emmanuel Brochier, maître de conférences en philosophie à l’IPC (Paris), pose pour Gènéthique, les jalons d’une critique[1].
Il y a donc une vérité. L’École de médecine de l’Université de Harvard vient de reconnaître que pas moins de 31 articles signés du Dr Piero Anversa « incluent des données falsifiées et/ou fabriquées ». L’histoire est émaillée de cas célèbres de fraude, ceux de Newton[2], de Galilée ou de Pascal notamment[3], lesquels n’ont en rien nui à la réputation scientifique de leur auteur, bien au contraire[4]. Mais ici l’attente était trop grande. On nous faisait espérer la capacité de savoir un jour régénérer des cœurs à partir de cellules souches issues du cœur lui-même. On aurait alors pu réparer l’irréparable. Et c’est pourquoi la faute s’est avérée impardonnable.
Augmentation, réparation, une frontière discutable
Ainsi, parce que l’attente en termes d’innovation, et ici de réparation, mais aussi peut-être d’augmentation, est désormais bien trop grande, personne n’oserait plus écrire comme en 1960 le grand historien des sciences Alexandre Koyré, que celui qui triche sur les données est autorisé à le faire dans la mesure où « ce n’est pas en suivant l’expérience, c’est en la devançant que progresse la pensée scientifique[5] ». La vérité sur ce qu’il est souhaitable de faire semble donc dépendre des objectifs qu’on se donne – moins sans doute à titre personnel que sur le plan sociétal. Or, du point de vue de l’histoire des mentalités contemporaines, il appert que réparer est un objectif avouable, tandis qu’augmenter semble plus discutable, quoique pas toujours, comme on le voit avec la chirurgie esthétique ou avec la contraception dont on estime qu’il n’est plus désormais possible d’en discuter, alors qu’il s’agit précisément d’un cas d’enhancement. On s’accordera toutefois pour dire qu’il revient à la philosophie de tout interroger et ce, sans exception. Alors, dans quelle mesure peut-on choisir d’agir sur le corps humain afin d’en modifier profondément les capacités ? En admettant qu’on puisse l’augmenter au nom de la liberté de disposer de son propre corps, cela n’impliquerait-il pas aussi l’obligation de le réparer, quel qu’en soit le prix, et même en fraudant au besoin ? Il est vraiment urgent de se demander où sont nos limites.
Entre la fin et les moyens
Le problème est d’abord que ni réparer ni augmenter ne constituent des fins en soi. On le sait dans la mesure où l’on ne délibère jamais sur les fins. Quel médecin, en effet, se demanderait s’il se doit d’assister une personne en danger ? On blâmerait avec raison quiconque aurait un simple moment d’hésitation. Certes, il arrive que l’augmentation ou la réparation deviennent un principe de l’éthique médicale[6]. Le problème est que l’on a toujours le choix entre réparer, c’est-à-dire rétablir une structure en son état initial, et augmenter, c’est-à-dire produire un état nouveau et plus performant. La fin, au contraire, est de l’ordre du nécessaire : elle se manifeste précisément comme ce qui ne peut pas ne pas être recherché. Admettons donc par hypothèse que la fin du médecin soit de réparer, son geste serait alors uniquement technique, et justifierait les moyens, y compris la fraude, si cette dernière devait être l’unique solution pour réussir, tout comme l’homme augmenté a pu justifier la volonté d’accélérer le progrès technologique et de mettre en place la convergence des nouvelles technologies[7]. Car il est entendu que pour un but déterminé, la technique impose des moyens déterminés. Mais un but d’ordre technique n’est pas une fin, sans quoi nous aurions une obligation de résultat. Et l’échec serait une faute. Or ce n’est pas le cas : les médecins, et plus généralement tous ceux qui exercent une compétence technique, ont seulement une obligation de moyens, sous réserve de quelques situations particulières[8].
La santé, une notion subjective
Toutefois, savoir distinguer l’objectif technique de la fin recherchée est loin de résoudre tous les problèmes. Chacun sait que la fin assignée au médecin est de l’ordre du soin, c’est-à-dire de la santé recouvrable par un acte médical. Le problème est que nous sommes de plus en plus nombreux à être les victimes d’un « ensorcellement » du langage (Wittgenstein). On apprend en effet que « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité[9] ». La santé ne serait donc plus un fait, mais un idéal. Pour le moins, il serait erroné de croire qu’elle se laisse mesurer par le ressenti du patient. À l’instar de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, elle se présente plutôt comme une idée régulatrice fondée sur un large consensus de personnes compétentes et représentatives. Ainsi entendue, elle est donc ce qui s’impose comme une règle sociale. Le problème est qu’elle n’est plus, comme le laisse pourtant entendre le langage ordinaire, un « état physiologique normal de l’organisme d’un être vivant, en particulier d’un être humain qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n’est atteinte, indépendamment d’anomalies ou d’infirmités dont le sujet peut être affecté[10] ». Dans son usage ordinaire, le mot santé implique une distinction nette entre réparer et augmenter : le médecin doit réparer, mais il outrepasse ses compétences lorsqu’il veut augmenter. En revanche, dans l’usage extraordinaire de la santé, la distinction se trouve déconstruite : augmenter devient une autre manière de soigner.
Le divorce de la médecine et de la morale
Mais il y a plus. Au-delà de l’ensorcellement du langage, nous avons perdu le sens du bien. En disant cela, nous ne cherchons qu’à formuler un simple constat. Jean-Marie Faroudja, président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins, n’a-t-il pas en effet déclaré il y a peu : « Il n’est pas dans notre rôle de dire ce qui est bien ou ce qui est mal[11] » ? C’est donc un fait : il est devenu évident que nous devons soigner par-delà le bien et le mal. Dans cette perspective, réparer et augmenter sont simplement des moyens dont il suffit de connaître le coût et les bénéfices pour un maximum de personnes. On comprend sans peine que le divorce de la médecine et de la morale ait fini par s’imposer comme une évidence, dans la mesure où il nous est désormais, et ce depuis longtemps, interdit de définir la vie d’un être vivant. Jadis, Socrate avait enseigné que pour connaître ce qui est bien, il faut se connaître soi-même et être capable de dire distinctement à quelle fin notre existence est ordonnée[12]. Mais le principe d’objectivité nous interdit toute explication par la finalité[13], et le spectre du vitalisme, toute définition de la vie[14]. Il reste cependant possible, semblerait-il, d’envisager l’homme comme une machine[15]. Ainsi pourquoi, quand soigner ne fait pas de bien, se contenter de réparer l’homme machine si nous pouvons, et voulons collectivement, en augmenter les capacités, en réhausser « la nature » ou en améliorer le senti ?
Un appel à la raison
Le problème est que nous pouvons naître en bonne santé sans aucune intervention médicale. L’expérience la plus ordinaire, mais aussi la plus commune, révèle ainsi que la santé relève d’abord de la nature. De ce fait, il ne sera jamais naïf d’affirmer que lorsque la santé fait défaut, le médecin soigne, la nature guérit, et que réparer ou augmenter ne sont ni des fins ni des moyens, mais seulement des circonstances : car on peut soigner en réparant, en augmentant ou en palliant. Quant à savoir ce qu’il est bon de faire, ni la science ni la technique ne pourront jamais le dire. Pour savoir composer la fin avec les moyens, il faudrait que Socrate eût à nouveau le droit de cité.
Conférences sur l’Intelligence artificielle et le transhumanisme
Emmanuel Brochier organise un cours tout public sur « L’intelligence artificielle : une opportunité pour le transhumanisme ? » Les séances ont lieu le mardi de 19h30 à 21h30, les 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre 2018 à L’IPC-Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie à Paris. Pour plus de renseignements et inscriptions : ipc-paris.fr ou contact@ipc-paris.fr.
[1] Cet article fait suite à un article d’Emmanuel Brochier précédemment publié par Gènéthique : De la « réparation » de l’homme à son « augmentation », où commence le transhumanisme ?
[2] Voir Richard S. Westfall, « Newton and the Fudge Factor » Science, 179 (1973), p. 751-758.
[3] Voir Gérard Nissim Amzallag, La Raison malmenée, Paris, Cnrs Éditions, 2002, p. 167-169.
[4] Voir Alexandre Koyré, « Le De Motu Gravium de Galilée. De l’expérience imaginaire et de son abus », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 13 (1960), p. 197-245.
[5] Ibid., p. 237.
[6] John Harris par exemple, dans Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People (Princeton, 2010), considère l’homme augmenté comme une fin qui nous oblige.
[7] Voir Roco, Bainbridge (eds), « Converging Technologies for Improving Human Performance » (Dordrecht, 2003).
[8] Voir loi n° 2002-2003 du 4 mars 2002.
[9] Constitution de l”O.M.S., 1985 [1946], p. 1.
[10] Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
[11] « Extension de l’AMP » (20/09/2018). Accessible en ligne : https://www.conseil-national.medecin.fr/node/29 29
[12] Voir Platon, Alcibiade majeur. De la nature de l’homme.
[13] Voir Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Seuil, 1970, p. 13.
[14] « Il suffit qu’on s’entende sur le mot vie, pour l’employer ; mais il faut surtout que nous sachions qu’il est illusoire et chimérique, contraire même à l’esprit de la science d’en chercher une définition absolue. » (Claude Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux (18852), Paris, Vrin, 1966, p. 24-25.)
[15] Voir notamment Nobert Wiener, God & Golem Inc., Cambridge (Massachusetts), The M.I.T. Press, 1964.