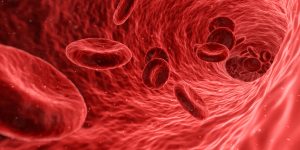N’est-il pas étonnant de voir l’engouement suscité par une loi qui traite du « droit des animaux » quand la vie humaine est menacée dès la conception jusqu’à sa fin ? C’est pourtant à partir de la spécificité humaine que le droit, qui codifie nos rapports humains et les liens avec ce qui nous entoure, a été établi. Jean-Marie Meyer, philosophe, propose des points de repère pour faire face à ces enjeux.
Le 28 janvier dernier le Parlement a reconnu aux animaux la qualité d’« êtres vivants doués de sensibilité1 ». Ce fait, à lui seul, ne pose pas de problème particulier car il n’indique pas de grande révolution immédiate dans la manière dont le Droit considère l’animal (Cf. Gènéthique vous informe du 5 février 2015). On sait, en effet depuis toujours que la vie animale se caractérise par des réactions sensibles et affectives. Quant au Droit, il lui faut déterminer qui est responsable lorsqu’un animal blesse une personne ou endommage les biens d’autrui. L’animal ne pouvant être responsable, c’est donc son propriétaire qui le sera. Sous ce rapport l’animal domestique est ici considéré lui aussi comme un « bien » de son maître.
L’homme, une espèce parmi d’autres ?
Ce n’est donc pas tant la décision du Parlement qui nous intéressera que la manière souvent problématique dont nos contemporains se représentent l’animal et vivent leur rapport avec lui. Nombre d’entre eux sont persuadés qu’en raison de la proximité entre l’espèce humaine et les autres êtres vivants, il conviendrait de conférer aux « autres », aux grands singes par exemple, des droits qu’il nous reviendrait de respecter. On peut alors s’interroger sur ce que cette perspective dévoile quant aux hésitations de notre culture et sur ce qu’il pourrait advenir de notre civilisation si l’homme lui-même ne devait plus être considéré que comme une espèce parmi d’autres sans que ses caractéristiques propres lui valent un respect strict et exclusif. On comprend alors quel est l’enjeu ultime de notre réflexion : c’est le sens de notre tradition juridique qui est ici en cause et, au-delà, l’existence ou non d’un humanisme qui traditionnellement fonde cette tradition. Jamais dans notre histoire, en effet, l’homme et la bête n’ont été mis sur un pied d’égalité et c’est cette conviction de fond qui réserve jusqu’à aujourd’hui le respect à la personne humaine.
A vrai dire, si la personne est respectable c’est d’abord parce qu’elle possède en elle-même le droit d’avoir des droits, c’est-à-dire une dignité. C’est cette singularité de l’homme qui est, au fond, l’objet des débats. Nos contemporains ont de plus en plus de mal à percevoir l’originalité de la personne et à tirer de cette connaissance les conséquences éthiques et juridiques qui en dépendent. Les lignes qui suivent voudraient apporter quelques points de repère pour éclairer la situation actuelle.
Des représentations de l’animal calquées sur l’homme
Il est en premier lieu nécessaire de mettre en garde contre une attitude très répandue et presque inévitable consistant à projeter sur l’animal nos différents états d’esprit. Ainsi, chacun d’entre nous va créditer son chat ou son chien de pensées ou de représentations qui existent bien en nous, animaux raisonnables, alors que rien n’indique objectivement qu’elles se retrouvent comme telles dans la psychologie de nos animaux familiers. Nos intérêts et notre légitime attachement pour les animaux rendus possibles par nos capacités cognitives risquent donc – et c’est le premier point – de nous égarer. Observons, d’ailleurs, une évidente dissymétrie : c’est nous, les êtres humains, qui interrogeons la vie animale et jamais eux, les autres animaux, qui s’interrogent consciemment sur cet étrange animal qu’est l’homme. Certes, bien des animaux communiquent entre eux mais aucun ne sait nommer les choses, ce qui montre qu’ils n’ont pas une connaissance profonde et surtout abstraite du monde dans lequel ils vivent.
En second lieu, certains éthologues présupposent que le comportement des animaux constitue une sorte de version simplifiée du nôtre comme si la manière dont nous réagissons au danger, par exemple, était déjà esquissée dans la vie des animaux. Or, une attention plus précise à l’originalité de la conduite humaine montre que chacun d’entre nous doit apprendre à évaluer ses actes en conscience et que ceci présuppose une réflexion, une histoire personnelle et collective qui n’a pas d’équivalent chez les autres espèces. La conduite des êtres humains passe par une adaptation à ce qui se fait autour d’eux mais elle amène aussi, selon les cas, l’agent moral qu’est la personne humaine à « ne pas faire comme tout le monde ». Par son refus d’un décret inique, Antigone demeure jusqu’à aujourd’hui un modèle très éloquent de ce qui caractérise en propre l’agir humain. Ici l’erreur de certains éthologues est de ne pas comprendre que si le dressage peut engendrer des comportements adaptés, l’éducation, elle, va bien au-delà, et n’a de sens qu’à rejoindre ce qui fait la grandeur de chaque personne : son coeur et sa conscience.
Certains vont même plus loin dans leur réduction de l’homme à l’animal et proposent de situer les bases de la vie morale dans la vie affective comme si l’empathie avec l’autre être sensible et souffrant était le vrai fondement de l’agir juste. De cette manière, il y aurait continuité naturelle entre les réactions des primates et les actions relevant de la morale.
L’animal à respecter ou à protéger ?
À cela il faut répondre que la justice regarde d’abord ce qui est dû à la personne de l’autre et non l’état affectif dans lequel je me trouve. L’affectivité, pour importante qu’elle soit n’est pas le principe du respect. D’ailleurs, l’appel au « respect de ce qui est dû » pose plus généralement le problème de savoir ce qui est dû à l’animal. Tel est, me semble-t-il, le point principal du débat. Beaucoup de partisans de la cause animale parlent, en effet, de respect de l’animal alors qu’il conviendrait en fait de parler de protection. Il s’agit de protéger des espèces alors que le respect s’adresse uniquement à des personnes. Ici, les mots ont leur importance car si l’on n’y prend pas garde c’est l’originalité de la personne humaine qui est mise de côté au nom du désir de promouvoir l’intérêt, légitime mais à sa place, pour les autres espèces. Souvenons-nous du dicton : « Qui trop embrasse, mal étreint ».A vouloir appliquer à l’animal ce qui ne doit aller qu’à l’homme -le respect-, on n’a pas enrichi la moralité humaine. On l’a plutôt fragilisée.
Une chose est plus que jamais nécessaire : redécouvrir la profondeur unique de chaque être humain, mon semblable, mon frère, afin de nous garder d’une extension du « droit » qui serait, en fait, l’implosion de notre dignité.
Une révolution régressive
Une dernière remarque aidera peut-être le lecteur à mieux comprendre ce que visent ces quelques lignes. À la fin du 18ème siècle, Jeremy Bentham, salué comme un prédécesseur par les militants de la cause animale, écrivait : « Il viendra un temps où l’humanité étendra son manteau sur tout ce qui respire. On a commencé par s’attendrir sur le sort des esclaves : on finira par adoucir celui des animaux qui servent à nos travaux et à nos besoins. »
L’essentiel apparait ici : lutter pour la « libération » de l’animal appartient à une « philosophie de l’histoire » d’un nouveau genre dans laquelle l’émancipation des noirs ne représente qu’une étape dans un processus qui dépasse l’espèce humaine. Jusqu’à présent c’était au nom de la dignité de l’homme que devait s’écrire notre histoire. La lutte pour l’égalité des hommes éclairait donc en profondeur, et de manière ô combien légitime, les combats contre le racisme. Pour les partisans du droit de l’animal, en revanche, cette originalité de l’homme soit n’existe pas soit ne vaut par reconnaissance de dignité. Il n’est donc pas nécessaire de réserver à l’homme des droits. Voilà pourquoi revendiquer des droits pour l’animal est une sorte de révolution régressive et appelle à la vigilance afin que personne n’oublie ce qui fait l’originalité sans prix de chaque personne humaine.
Jean-Marie Meyer
Professeur agrégé, né en 1955, il enseigne la philosophie générale en classes préparatoires et l’éthique à la Faculté libre de philosophie comparée (IPC). Il est membre du Conseil pontifical pour la famille.




![Persona non grata [1/2] main et pied de bébé](https://www.genethique.org/wp-content/uploads/2022/05/bebe-g76d97112c_1920-510x382.jpg)