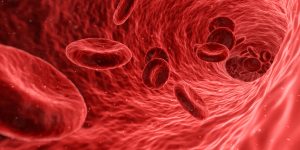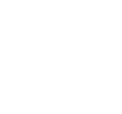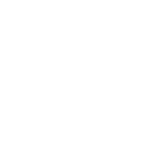Aujourd’hui, « 93 % des 40 000 personnes qui font une mort subite chaque année en France ne survivent pas ». Pour l’AP-HP, « elles représentent une source potentielle importante, mais encore sous-utilisée, de greffons ».
Un constat qui ouvre un vaste champ de réflexion : « Jusqu’où faut-il réanimer les victimes de ‘mort subite par arrêt cardiaque’ ? A partir de quand cesser la réanimation pour envisager une procédure de prélèvements d’organes ? ».
Pour la philosophe Sylviane Agacinski, « les nouvelles techniques médicales bouleversent profondément la manière de penser la vie et la mort et de considérer le corps humain ». Les progrès de la médecine ont modifié les comportements des médecins qui jusqu’ici n’avait, comme ultime objectif, que de réanimer les patients.
Des critères pour permettre une évaluation la plus rapide possible des « chances » de survie après un arrêt cardiaque (cf : Don d’organes : trois critères pour accélérer les prélèvements en cas d’arrêt cardiaque) ont été mis en évidence. Ils doivent permettre « de connaître en 10 à 15 minutes le pronostic de ces patients, au lieu de les réanimer en vain durant 45 minutes », précise Xavier Jouven de l’HEGP, qui a coordonné ce travail. Un progrès quand le prélèvement d’organes s’inscrit dans une véritable « course contre la montre », car « le patient doit atteindre un hôpital habilité pour le prélèvement moins de 150 minutes après l’arrêt cardiaque ». Et dans un contexte de pénurie de greffons, Xavier Jouvan évalue à un millier, le nombre de personnes en France qui pourraient ainsi potentiellement devenir donneurs.
Cette pratique n’est pas sans soulever des questions éthiques. Arnaud Le Jan, infirmier, expliquait dans la revue Soins de septembre que « face à des patients qui font une mort subite, l’équipe de réanimation ‘se trouve dans une dualité de prise en charge, entre poursuite – vaine ? – des manœuvres de survie et promesse – vitale ? – de greffe’ ». « Il ne faudrait pas que les médecins soient perçus comme des vautours », avance Xavier Jouven.
En France, les greffons de rein proviennent pour 16 % de donneurs vivants et pour 84 % de donneurs décédés. Les donneurs décédés, étaient en état de mort cérébrale pour 95 % d’entre eux, et « 5 % étaient morts d’un arrêt cardiaque ». « En Espagne, ce dernier taux est de 17 % ; aux Etats-Unis, de 18 % ».
Le Monde (Florence Rosier) 24/10/2016