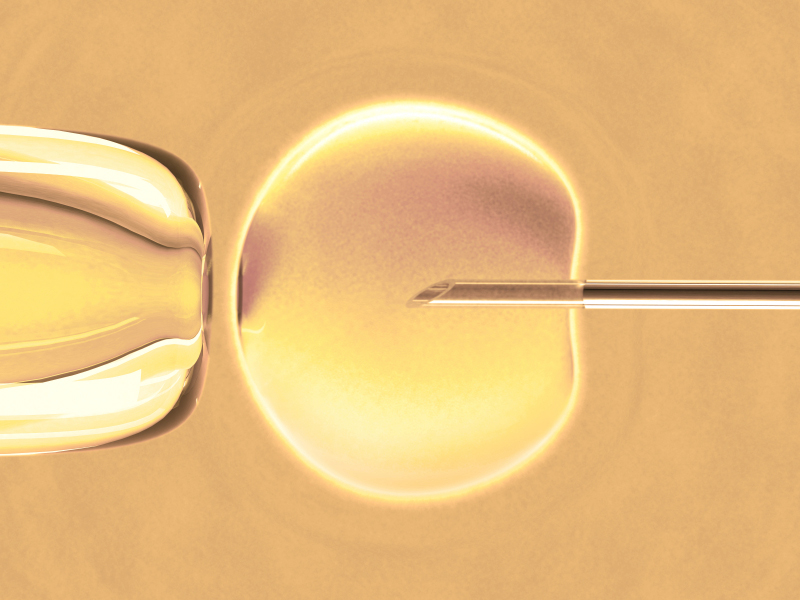Ce récent essai mêle l’autobiographie intellectuelle – les chapitres III et VI évoquent la rencontre concrète de l’auteur avec le monde de la FIVETE et ses réactions quasi instinctives de psychanalyste – et une analyse sans concession des secteurs des sciences du vivant situés à l’intersection de la génétique (dans sa dimension prédictive notamment) et de la médecine de la reproduction.
Au centre du livre, on trouve le diagnostic lucide de la présence de noyaux pulsionnels inconscients, tant individuels que collectifs, à l’œuvre dans certaines des avancées technologiques les plus spectaculaires. Dans une formule frappante, H. Atlan avait récemment stigmatisé les perspectives de clonage thérapeutique comme « un renouvellement des antiques pratiques de sacrifice humain ». Avec une remarquable sûreté de jugement, Monette Vacquin met en lumière que le mythe sous-jacent à la problématique de la FIVETE et ses multiples développements est celui d’Œdipe et non pas celui de Prométhée :
« Repérer Œdipe, et non plus Prométhée, comme le mythe sous-jacent d’une démarche « scientifique », en l’occurrence le rapt accompli par la biologie sur la procréation, est une façon de nommer le malaise éprouvé devant l’impression de non-scientificité. (…) Repérer Œdipe, c’est donc rendre compte à la fois de la cécité de la biologie sur ce qui l’anime, de sa toute-puissance, de sa volonté d’occuper toutes les places, pour finir dans leur totale confusion. Dans le clonage, le père et le fils se confondent dans l’effacement de toute loi d’altérité, de la loi primordiale de l’interdit de l’inceste qui, marquant une limite à la jouissance, construit l’espace de la culture, aménage le temps, le neuf, la création. Ce qui tend au clonage, à la production du même, à l’abolition de toute altérité, dessine l’espace mortifère, psychotique et psychotisant, de la répétition. Tenaillé par la question de son identité, Œdipe ne semble pas disposer de mots pour la déployer (…). Il l’explore au scalpel, l’œil rivé au microscope, dont les merveilles lui masquent sa propre question. Incapable d’en formuler la genèse, il met en pièces la généalogie. C’est une illusion, naturellement…(p.42-43)
Certes, et Monette Vacquin le sait bien, une dynamique de volonté de puissance est à l’œuvre dans le secteur des procréations médicalement assistées et de la réduction inconditionnelle de l’organisme vivant à la composition chimique de certains segments (les introns) de la molécule d’ADN. De ce point de vue, la référence aux mythes de Faust et de Prométhée se justifie parfaitement. Mais, et c’est la force de l’auteur, cette volonté de maîtrise et, corrélativement, les mythes qui l’expriment, ne sont pas premiers.
Ce qui caractérise fondamentalement le monde des PMA, c’est à la fois qu’elles s’inscrivent dans une culture qui a perdu ses repères quant à son origine et qui, réciproquement, rend ambiguë l’apparition même de l’homme. A la racine de cette problématique, on trouve une irruption de l’angoisse oedipienne, celle qui s’empare du moi individuel ou du moi collectif lorsque, ne pouvant se situer clairement par rapport à leur moment initial, ils se trouvent aspirés dans le vertige d’un surgissement énigmatique. Ce silence ou cette nuit de l’origine autorise que tout un chacun joue en définitive tous les rôles : combien de fois le médecin ne s’est-il pas déclaré le père de l’enfant au terme d’une FIVETE réussie, lapsus révélateur ? Cette ambiguïté déstructurante rend compte de la pulsion épistémophilique – entendons par ce terme la quête d’une maîtrise conceptuelle et technologique de la transmission de la vie – perceptible dans ces pratiques. Elle explique l’agressivité et la violence du discours encadrant ces secteurs et présentes en cet âge prétendument scientifique. Mais, au 5ème siècle avant Jésus-Christ déjà, Platon n’avait-il pas mis en évidence une violence analogue dans le discours des sophistes ? Et c’est en définitive cette question philosophique de fond, celle du rapport entre le langage et la vérité, qui gouverne Main basse sur le vivant :
« Si une catastrophe se produisit dans la décennie qui précéda le vote des lois dites de bioéthique, elle fut avant tout langagière. C’est grâce à des mots flambants neufs que les rationalisations furent prises pour argent comptant, recouvrirent des motifs peu accessibles, grisèrent les esprits.»
Cette même nuit des origines éclaire en dernier ressort le retour en force de l’eugénisme, ce démon des démocraties occidentales à l’aube du 20ème siècle et que l’on croyait à jamais relégué dans les souvenirs de l’Histoire suite aux horreurs nazies. Après tout, les Jugements de Nuremberg – tant celui des hauts dignitaires nazis que celui des médecins criminels – et la Déclaration universelle des Droits de l’homme (10 décembre 1948) ne devaient-ils pas inaugurer une ère nouvelle, celle du « plus jamais cela » ? Force est de constater qu’il n’en est rien et que la tension vers un génome parfait, aussi utopique soit-elle, tend à remplacer aujourd’hui la recherche d’une pureté de la race. Nous voici renvoyés au mythe de Frankenstein, lequel sert de fil conducteur à la pensée de Monette Vacquin. Mary Shelley avait laissé parler son génie de femme pour rappeler, au soir des Lumières et du rationalisme triomphant, que le mystère ultime de l’homme réside dans l’ordre du cœur, ou, plus exactement, d’une soumission du règne de la raison à celui de l’amour. L’un des effets secondaires des multiples interrogations que suscitent aujourd’hui les programmes de maîtrise de la transmission de la vie, de sélection des oeufs bien formés par les techniques de diagnostic prénatal, de réduction du vivant à son organisation génétique, sera peut-être de nous faire comprendre que le ressort secret du roman de Mary Shelley, la révolte d’une créature artificielle, ne s’enclenche que parce que Frankenstein se découvre engendré sans amour