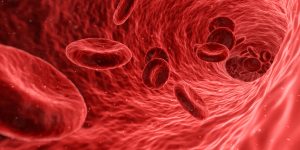L’inflation du droit entraîne une multiplication proportionnelle des devoirs. Elle oblige le citoyen à se placer en conscience devant les injonctions de la loi et à se déterminer.
Pour ne se limiter qu’au domaine de la santé, l’IVG, la PMA, les manipulations sur l’embryon et, depuis 2015, la fin de vie, entre autres, placent les professionnels devant un certain nombre de défis éthiques qui mettent à mal leurs convictions. Avec la multiplication des normes édictées par l’Etat, il y a fort à parier que l’individu, confronté à un nombre croissant de contraintes, sera de plus en plus souvent renvoyé à sa conscience. Et quand ce que la loi demande s’oppose à cette conscience, le recours à l’objection ne s’impose pas seulement comme un droit, mais comme un devoir.
Historiquement, l’objection de conscience naît avec la modernité, quand la loi devient l’expression, non plus de la vérité, mais de la volonté générale. La loi se transforme en instrument au service d’un pouvoir qui devient arbitraire, et dont la volonté affichée est d’améliorer l’homme. Mais selon quels critères désormais ? Avec la seconde guerre mondiale, les démocraties prennent conscience qu’elles peuvent conduire à un régime totalitaire. Pour se protéger de nouvelles dérives, elles instaurent la Déclaration Universelle des droits de l’homme, qui sera promulguée en 1948, un ensemble de principes qu’elles établissent au-dessus de la démocratie, mais qui s’agrège néanmoins sur la base d’un contrat social qui montre ses limites.
La question de l’objection de conscience a été abordée lors des Journées de Bioéthique de Paray-le-Monial[1]. Cet article a été élaboré notamment à partir des grandes lignes de l’intervention du philosophe Thibaud Collin[2].
Au risque de la schizophrénie
La société contemporaine repose sur une dualité entre la pensée et l’agir : si chacun dispose d’une grande liberté de pensée, le prix à payer est que l’action trouve sa mesure dans la loi. Et la loi, commune à tous, doit être respectée pour éviter de tourner à l’anarchie.
Les principes qui sous-tendent cet actuel « vivre ensemble » sont ceux qui avaient cours au XVIIe siècle, tels qu’ont pu les formuler Hobbes ou Spinoza. Ces philosophes considéraient que la guerre civile, c’est-à-dire, la guerre de tous par tous était le pire des maux. Ils situaient l’origine de ces guerres dans le fait d’avoir une opinion et de vouloir l’imposer aux autres. Aussi, dans le type de contrat social qu’ils cherchent à mettre en place, si la liberté d’opinion et de pensée est totale, elle doit être circonscrite… à ma propre tête. Et dans la mise en œuvre de mes convictions, dans ce qui a trait au domaine de l’action, c’est la contrainte de la loi qui pose le cadre pour éviter la guerre de tous par tous. La paix, ainsi obtenue et entretenue, se construit sur l’inévitable séparation de la pensée et de l’action.
Appliqué à la question de l’avortement par exemple, ce principe suppose que si chaque personne est libre d’être contre l’IVG, il lui est impossible de refuser de le pratiquer parce qu’il contraint une femme à ne pas avorter : or, le droit implique le devoir de respecter mon droit, parce que dans ce cadre, l’agir ne peut être conforme à la pensée. Un tel état des choses conduirait à l’anarchie. Pour maintenir cette position, il faut que la vie commune soit fondée sur une autorité arbitraire : « Ce qui fait la loi, ce n’est pas la vérité », explique Hobbes, « c’est l’autorité »[3].
En distinguant la sphère privée de la sphère publique, l’individu s’insère dans une logique des droits qui fonctionne comme un impératif. Impératif qui, dans nos sociétés, a été fort bien intégré et qui explique l’intolérance actuelle vis-à-vis de l’objection de conscience : objecter implique nécessairement de se soustraire à la loi. Aussi, si l’exercice de la clause de conscience est théoriquement possible, elle est, en réalité, très difficile à mettre en œuvre parce qu’elle apparaît comme une forme de contestation de la loi. Comme tel, celui qui objecte dérange et pose question. Il rappelle « ce qu’on n’a pas envie d’entendre ». Plus ou moins inconsciemment, il renvoie les personnes à leur propre conscience : pourquoi es-tu différent alors que la loi semble au service de tous ?
Pourquoi objecter ?
Face au défi de la loi, la conscience morale obéit à quelque chose de plus grand qu’elle. Celui qui objecte est témoin de quelque chose d’universel, il est au service du bien commun. La loi, en effet, tient sa légitimité de ce qu’elle subordonne l’agir au bien commun. Aussi, faisant l’expérience de la conscience morale, il fait l’expérience d’être lié, obligé d’agir à l’encontre de ce que lui indique la loi positive. En objectant, l’individu interpelle la loi en lui rappelant sa raison d’être.
La conscience morale comprend une faculté qui permet de connaître la vérité, la réalité telle qu’elle est. Elle pose un acte de la raison, un jugement de la raison, qui touche l’expérience du remords, de l’obligation[4]. C’est en raison de ce lien existentiel entre notre intelligence et l’exigence de la vérité que nous pouvons éprouver l’obligation de ne pas nous soumettre à une loi qui bafouerait cette vérité. Et s’il y a toujours quelque chose de sur mesure dans la conscience morale, le jugement s’établit à la lumière d’une vérité universelle. Dans l’acte posé ou à poser, c’est en référence à cette vérité universelle que la raison détermine l’acte bon à réaliser ou l’acte mauvais à éviter.
De plus, la décision d’agir conformément à sa conscience est particulièrement importante parce qu’elle permet à la personne, dans telle situation, d’accomplir son être humain, de se réaliser en tant que personne humaine. La conscience est médiatrice de la loi naturelle, qui est un chemin de vie par lequel l’homme se découvre fidèle à ce qui le constitue profondément comme être humain. Par cette voie, tout homme est capable de trouver le bonheur. Celui qui obéit à sa conscience, lui obéit comme à la médiatrice d’une vérité profonde sur l’être humain.
Rendre raison de ses actes
En agissant conformément à sa conscience morale, l’objecteur, qui utilise sa raison, entre dans la faculté de connaître qui a trait à la vérité. Il cherche le bien à réaliser et le mal à éviteret il peut rendre raison des motifs qui le pousse à la contestation : l’acte comporte une dimension objective qui le justifie. L’objecteur ne refuse pas pour refuser. Il est prêt à entendre les objections qui lui sont opposées, il n’est pas enfermé dans sa bulle. Il rend témoignage de son refus. En adressant une parole, en agissant selon ce qu’il croit juste et bon, il affirme l’unité de sa personne et de la vérité, dans le souci du bien commun. C’est pour cette raison que, la conscience morale étant le juge le plus proche de l’action, il est essentiel que chaque personne puisse suivre sa conscience, ce qui implique d’être particulièrement vigilant à sa formation !
Enfin, l’objecteur a le souci de ce qui caractérise un être humain, sa dignité. Cette dignité humaine se révèle particulièrement quand il agit pour se réaliser à travers ses actes pour rejoindre, par elle, la vérité sur lui-même.
Pour cela, il a besoin d’approfondir, d’être sûr que la décision qu’il prend ici et maintenant, et qu’il devra assumer, repose sur le vrai bien. Il récuse toute dynamique du moindre mal qui reste un mal contre la dignité de l’être humain. Il le tolère cependant quand il n’implique pas de faire le mal même en vue d’un bien, mais de le supporter pour en éviter un plus grave. En ce sens, il est pleinement cohérent. Pas d’une cohérence « normale », mais comme nourrie par la recherche de la vérité : cette cohérence est celle de l’être humain qui reconnait qu’il n’est pas la source de la dignité humaine, mais qui l’assume pleinement. Dans la vie qui est la sienne, il ne joue pas un personnage. Et tout en investissant pleinement le poids de son existence humaine, il refuse une légèreté, une insouciance qui l’éloigne de ce qu’il est appelé à être.
Etant cause de ses actes, jusqu’à en assumer les conséquences parfois dramatiques, l’objecteur manifeste la plénitude de sa liberté humaine. Une liberté qui, dans un monde encadré par un « prêt-à-penser » souvent à l’origine d’un « prêt-à-agir », peut avoir le tort d’apparaître, à son corps défendant, comme une provocation extrême.