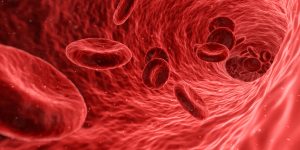D’amour ou de haine, la modernité a considérablement modifié la façon dont nous considérions notre corps jusqu’à la vision transhumaniste qui fait du corps une obsolescence indésirable. Retour sur une conférence du Forum européen de bioéthique.
Le corps des personnes que nous sommes est la condition de notre présence au monde : « nous sommes un corps, nous n’avons pas un corps », rappelle David le Breton, anthropologue et sociologue. La condition humaine est une condition corporelle. Aujourd’hui, l’individuation de notre rapport au monde se fait par le corps : chacun décide de ses valeurs, de son mode de vie…
Le corps fait l’individu
L’individu apparait dans les années 1980 quand disparait la culture de classes avec la fin de la bourgeoisie et du syndicalisme. Une fin qui joue la rupture de la transmission et du rapport au monde vécue à travers l’appartenance au groupe. La dissolution de toutes les cultures va conduire à l’individualisme, désormais la personne se singularise à travers son corps. Le souci du corps loin d’une culture du « nous autres », qui est celle de l’appartenance à une communauté.
Quand on est un individu, le corps est ce qui nous distingue les uns des autres. Le corps, signe aussi notre présence physique au monde, est comme absolutisé ; il est la frontière de notre personne, quand la frontière dans une culture de classe, était celle de la communauté, celle du groupe.
Précédemment, au XVe siècle, l’anatomie émerge et change elle aussi le rapport au corps, qui va se distinguer peu à peu de la personne, pour devenir force et limite de la personne. Les anatomistes vont élaborer un savoir de l’espèce humaine universel différent du corps de l’individu qui est ce qui nous distingue les uns des autres. Dans un de ses écrits, Marguerite Yourcenar raconte l’histoire d’un homme qui meurt et qui n’est plus ni le fils, ni l’ami mais « un bel exemplaire de la machine humaine »[1]. Pourtant « quand je vous regarde », explique David le Breton, « je ne vois aucun corps, je vois des hommes et des femmes ». Et il rappelle que dans certaines sociétés, il n’existe pas de mots pour désigner le corps. La personne est un tout indissociable.
Du corps remodelé au corps dématérialisé
L’individuation du corps s’accompagne d’une individuation du sens, des significations avec lesquelles on vit, et qui implique de « reprendre sa vie en main » avec un corps qui nous appartient en propre. En même temps, ce corps devient une propriété provisoire et modelable qui se traduit par la « percée fulgurante du tatouage, du piercing, du culturisme ou de la chirurgie esthétique. Des démarches qui étaient encore stigmatisées dans les années 1970 ». Cet engouement pour modifier les conditions de son corps traduit le fait que « le corps devient une proposition » qui va jusqu’au transgenre, à la transsexualité. Ce type de désir est démédicalisation, dépathologisation et la proposition du sexe indécidable, qui fait le lit de la théorie du queer, émerge. Dans cette théorie, chacun crée un genre à soi tout seul avec des corps insolites.
Avec le transhumanisme ou le post-humanisme une nouvelle étape est franchie, celle de l’obsolescence des corps. L’identité, devenue évanescente, le corps est mis au service des changements d’identité, remaniée par les offres du marché et de la médecine.
La haine du corps apparait vers la fin des années 90. Les extropiens[2], un courant du transhumanisme, considère qu’il faut changer la nature du corps, qui devient anachronique et dérisoire. Il faut inventer des techniques pour aboutir à un surhomme en vue de créer une post-humanité post-biologique, un post-darwinisme.
Aujourd’hui, le discours transhumaniste s’est beaucoup démocratisé. Il est surtout le fait d’hommes, très peu de femmes s’y intéressent. Désormais, il ne s’agit même plus de changer le corps mais de s’affranchir d’un « corps cafard ». Le corps est dépassé. Cette haine du corps rappelle des mouvances gnostiques de l’antiquité et… l’univers de Matrix… Le corps est objet de mépris parce qu’il est soumis au vieillissement, à la maladie, mais aussi à la blessure, et bien sûr, à la mort. « Le corps étant le lieu de la mort, il faut supprimer le corps et vivre en dehors du corps ». Aux Etats-Unis, ces thèses conduisent à un ultra puritanisme qui estime que « la sexualité est faite pour les singes ».
Le corps devra être remplacé par des prothèses, l’esprit sera téléchargé sur le net, et des avatars seront créés. Tout ce qui fait notre vie actuelle est composé d’informations, aussi pour les post-humanistes, notre vie est à transformer en information. Par la synthèse de toutes les informations que nous avons en nous, nous devenons la machine, quelque chose d’hybride. Le transhumanisme nie le corps ou le maitrise. Il se présente comme la seule possibilité d’élévation de l’homme, et veut s’imposer comme seule vérité face à une fin du monde programmée. La radicalisation de la pensée transhumaniste ne peut que conduire à des excès…
Marcher pour résister
Pourtant le corps, même s’il parait désuet, nous permet de vivre et de comprendre pourquoi nous vivons. Et l’attachement que nous lui portons est fort heureusement très fort. David le Breton estime qu’il faut dénoncer « ces imaginaires technophiles, ces fantasmes technologiques, qui n’auront pas d’incidence sur les générations à venir ».
A un étudiant qui l’interrogeait sur l’empreinte numérique : « Est-ce que la trace que nous laissons sur le net n’est pas ce qui fait désormais la vie ? », David le Breton répond que l’utopie transhumaniste n’a pas pour objectif d’ « améliorer le goût de vivre », c’est-à-dire de permettre de partager du bonheur, c’est une idéologie ultra libérale qui vise à plus d’efficacité, plus de performance et qui s’oppose complètement aux valeurs d’amitié, de bonheur, de solidarité, de bienveillance, mais « en éliminant le corps, on oublie le goût de vivre ». Une contradiction redoutable pour une utopie qui veut l’homme immortel !
Aujourd’hui, si la marche rencontre un succès inouïe, c’est parce qu’elle est la forme contemporaine de résistance aux attaques portées contre le corps. Elle permet de reprendre sa vie en main en renouant avec la jouissance du temps, du sens de l’autre.