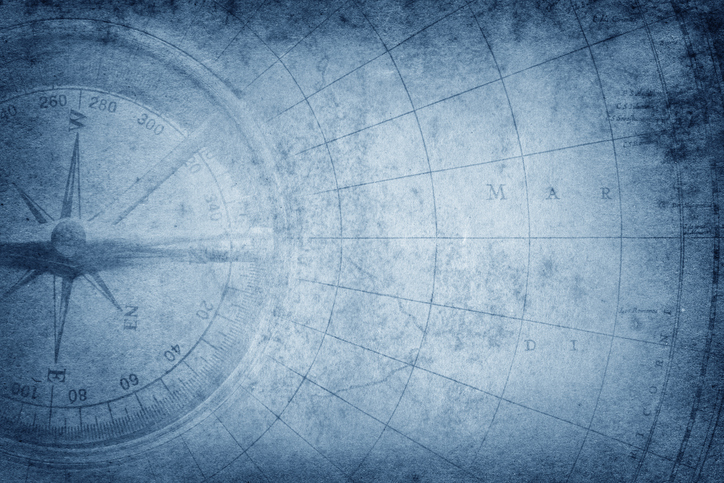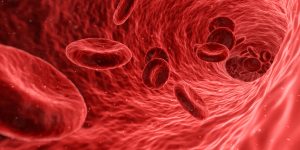Au-delà de la question de l’ouverture de la PMA aux femmes seules ou en couple, le projet de loi de bioéthique contient un certain nombre de points qui méritent une attention particulière. Camille Yaouanc, est docteur en pharmacie et a fait un master bioéthique, elle intervient régulièrement sur Gènéthique, elle fait le point sur le dépistage des maladies du bébé avant la naissance.
Gènéthique : De quoi on parle quand on par le diagnostic prénatal ?
CY : Le Diagnostic prénatal a pour objectif de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus « une affection d’une particulière gravité », soit en raison des risques génétiques des parents ou de leurs familles, soit après la découverte d’anomalies fœtales à l’échographie soit encore de façon systématique pour la trisomie 21.
Lorsqu’une anomalie fœtale est détectée, elle doit être attestée par des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN), eux-mêmes encadrés et agréés par l’Agence de Biomédecine. En 2016, ces centres ont délivré plus de 7000 autorisations d’interruption médicale de grossesse pour motif médical, qui est l’issue la plus « courante » suite au diagnostic d’une anomalie de l’enfant à naitre.
G : En matière de dépistage prénatal, qu’est-ce qui est autorisé aujourd’hui en France ?
CY : Le Diagnostic Prénatal repose sur des examens d’imagerie et des dosages biologiques, mais aussi sur des examens plus invasifs. Les premiers tests effectués au cours de la grossesse sont généralement des tests de DEPISTAGE (échographie, dosages sanguins à parti d’une prise de sang de la mère), et orientent vers la nécessité ou non de réaliser un DIAGNOSTIC, en général via un geste invasif, une amniocentèse ou un prélèvement de villosités choriales, examens qui comportent un risque de fausse couche.
Le dépistage prénatal de la trisomie 21 est un « cas particulier » : les professionnels de santé ont l’obligation de le proposer à toutes les femmes enceintes. Il est systématisé, et largement banalisé. Il repose sur la mesure de la clarté nucale à l’échographie du premier trimestre et sur le dosage des marqueurs sériques via une prise de sang de la mère. S’ensuit un « calcul de risque », qui prend également en compte l’âge de la mère, en fonction duquel est proposé à la femme enceinte une nouvelle étape : le diagnostic prénatal non invasif, via une nouvelle prise de sang, et si le « risque » est encore avéré, une amniocentèse est alors proposée. Une batterie d’examens qui peut se révéler anxiogène pour la femme, et conduire finalement à un résultat négatif. Mais derrière tous ces tests se cache aussi un marché financier très lucratif !
G : Dans le cadre d’une PMA quels sont les examens pratiqués sur l’embryon ?
CY : Sur l’embryon, on réalise ce qu’on appelle un diagnostic préimplantatoire (DPI), qui est une technique de sélection des embryons après une fécondation in vitro. Elle est autorisée depuis 1999 pour les couples en parcours d’AMP ayant « une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Aujourd’hui, le DPI ne peut avoir pour objet que de rechercher cette affection et les moyens de la prévenir ou de la traiter. En 2016, 694 DPI ont été pratiqués et 199 enfants sont nés à l’issue d’un tel tri. C’est une véritable pratique eugénique.
G : Aujourd’hui que propose la loi de bioéthique dans le domaine du diagnostic sur l’embryon et le fœtus ?
CY : Il y a quelques petits points positifs mais aussi le risque de grosses dérives. En ce qui concerne le diagnostic prénatal, le projet de loi bioéthique prévoit de modifier sa définition pour accentuer la dimension de soin in utero, ce qui est positif. Le texte ajoute aussi l’obligation de proposer une liste d’associations spécialisées en cas de diagnostic d’une affection d’une particulière gravité, ce qui représente également une belle avancée.
Cependant, le projet du gouvernement inclut une autre mesure, alarmante : dans le cas d’une découverte génétique « fortuite », c’est-à-dire non recherchée lors des examens habituels, une enquête génétique sera alors menée chez les deux parents. Le diagnostic prénatal n’a plus dans cette perspective le seul but de contrôler le bon déroulement de la grossesse, mais devient un moyen d’investigation à visée eugénique de l’état génétique de la population.
Pour ce qui est du diagnostic préimplantatoire, le projet de loi prévoit que le ministère de la santé instaure par arrêté, sur proposition de l’agence de biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire. Une mesure supplémentaire d’encadrement de cette pratique eugéniste, toutefois ce n’est pas ce qui était attendu : certains professionnels de l’AMP revendiquent l’extension du DPI aux aneuploïdies, c’est-à-dire à toutes les anomalies du nombre de chromosomes, y compris la trisomie 21. Cette revendication était présente dans tous les rapports institutionnels préparatoires à la révision de la loi de bioéthique. Elle a fait l’objet d’un débat lors de l’examen du projet de loi en Commission mi-septembre, mais n’est pas soutenue par la ministre de la santé Agnès Buzyn, qui la qualifie de « dérive eugénique claire ».
Cette extension est réclamée au motif qu’elle améliorerait le taux d’implantation suite à une fécondation in vitro, mais cette affirmation n’est pas prouvée scientifiquement. Elle pourrait concerner tous les couples qui ont recours à la PMA. Et de fait, en couplant cette mesure avec la suppression du critère d’infertilité pour recourir à la PMA, il deviendrait alors possible pour n’importe quel couple de recourir au DPI pour trier ses embryons.
Lors des précédentes révisions de la loi de bioéthique, cette revendication avait déjà fait débat. Elle avait été refusée pour éviter l’aggravation de la stigmatisation des personnes trisomiques 21, pour éviter que ce dépistage ne se systématise et ne s’étende à d’autres pathologies ainsi qu’en raison de difficultés techniques impactant la fiabilité du DPI. Autoriser la détection de la trisomie 21 par DPI c’est « établir une liste des pathologies susceptibles d’être recherchées dans le cadre d’un DPI avait alerté Jacques Testart en 2011. Je rappelle que les nazis ont dressé des listes des « tares », comme les Japonais après-guerre et les Chinois dans les années 1990. Le seul pays qui ait constitué une liste de ce type pour le DPI – de façon fort discrète – est, à ce jour, la Grande-Bretagne. On peut trouver les quelque 65 pathologies sur le site Internet de la Haute autorité chargée de la régulation des activités d’assistance médicale à la procréation et à la recherche en embryologie (HFEA). Cette solution heurte le respect que l’on doit aux personnes malades. De plus, ces listes ne peuvent être qu’extensibles. »
G : On parle aussi beaucoup de diagnostic préconceptionnel. De quoi s’agit-il ?
CY : Les tests de diagnostic préconceptionnel sont des tests génétiques visant à déterminer les maladies que les parents pourraient transmettre à leurs enfants, avant même la conception de ces enfants. Le principe, identifier les porteurs sains de maladies génétiques, n’est pas nouveau, mais ça prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec la possibilité de tester des centaines d’affections en même temps avec le séquençage haut débit. En cas de résultats positifs, c’est-à-dire si les deux parents sont porteurs sains d’une mutation, ils seraient alors orientés vers une fécondation in vitro suivie d’un diagnostic préimplantatoire afin d’éliminer tout embryon porteur de cette maladie potentielle. Le CCNE estime que le recours au diagnostic préconceptionnel « permettrait de réduire l’incidence de certaines maladies génétiques graves », mais cela n’est vrai que si l’on interdit la procréation aux couples découverts à risques alerte là encore Jacques Testart.
Le CCNE est d’ailleurs favorable à l’autorisation de ces tests, et à leur remboursement par la sécurité sociale. Cependant le projet de loi n’en parle pas, et la commission spéciale n’a pas amendé le texte en ce sens. La question devrait de nouveau revenir lors du débat en séance à l’Assemblée, qui a commencé le 24 septembre.
G : Ces tests s’adressant aux parents, les enjeux sont-ils les mêmes ?
CY : Pas tout à fait effectivement. Si les deux parents sont porteurs d’une mutation en cause d’une maladie génétique récessive, ils ont alors 25% de risques d’avoir des enfants atteints de cette maladie. Dans le cas de populations qui risquent de transmettre le gène responsable de la thalassémie par exemple, un test de dépistage génétique est licite et même recommandé : il peut représenter une véritable prévention et une alternative à l’avortement sélectif. Cependant, ces examens ne peuvent pas être rendus obligatoires au travers de « dépistages systématiques » ou de lois imposées de façon générale aux couples. Le résultat du test doit engager le seul couple, à réaliser son choix de procréer ou non en conscience.
De plus, les problèmes arrivent lorsque le couple est incité à recourir au DPI, avec les enjeux évoqués plus haut. Il est aussi préoccupant et anxiogène de voir la liste des maladies potentielles dépistées s’allonger. Le risque de médicaliser la reproduction humaine, de discriminer les personnes atteintes de ces maladies, ou encore le risque d’intrusion dans les choix du couple sont bel et bien présents avec le diagnostic préconceptionnel.