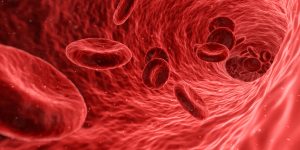Qu’est-ce que la mort ? Comment mourir ? Jusqu’où souffrir ? Où est le curseur ? Un sujet quasi tabou dans une société de la performance mais des questions sous-jacentes au débat actuel sur l’euthanasie, nombreuses, complexes, cruciales. Deux auteurs avancent des éléments de réponses, frontalement opposées, mais inquiétantes l’une comme l’autre.
« Si la mort est une fin, la vie appartient aux hommes, si la mort est un passage, la vie appartient à Dieu » pointe Jean Leonetti[1], député-maire d’Antibes, médecin, qui plante le décor socio-culturel avant de développer sa réflexion autour de la fin de vie. Et Leonetti d’expliquer comment la désacralisation de la mort l’a aussi désocialisée, dans « une légitimité croissante de l’individu sur le collectif », tandis que la perte de sens l’a faite basculée d’« insensée » à « impensée », au risque de substituer l’orthopraxis à l’orthodoxie et de passer du techniquement « faisable » à un impérieux « souhaitable ».
Un pas que franchit résolument Jean-Luc Roméro[2], maire du XIIè arrondissement parisien, président de l’AMDM[3]. Il appelle de ses vœux une « mort idéale », propre, sans fautes, en quelques secondes, par injection létale, prenant pour modèle les pays du Benelux qui ont légalisé l’euthanasie : les patients « font venir leurs proches, les gens qu’ils aiment, ils ont le temps de tout se dire, d’échanger, de faire leurs adieux ». Les dernières volontés du patient sont souveraines : sa décision de mourir, le moment de sa mort, le choix des personnes à voir, le recours aux soignants. Une façon, selon Leonetti, de diluer le tragique de la mort dans un hyper-volontarisme et d’en transférer la responsabilité au médecin en l’instrumentalisant à ses fins. En d’autres termes, derrière l’apparente fragilité du candidat à l’euthanasie se cache une toute puissance qui exalte sa liberté en niant celle d’autrui.
Séropositif depuis l’âge de 27 ans, Roméro a vu mourir de nombreux malades du sida, des amis proches qu’il a accompagnés. Témoin de leurs souffrances multiples et parfois de l’indifférence du personnel soignant, aujourd’hui, il plaide pour un « faire mourir » en opposition au « laisser mourir » dont il accuse les médecins, Leonetti en particulier qu’il attaque à longueur de pages. D’ailleurs, Roméro rejette avec autant de virulence la réflexion de l’Église, obscurantiste, que celle de l’ordre des médecins, corporatiste. Et sous un déluge de bons sentiments, il impose un diktat qui brise le pacte social du respect de la vie et fait basculer la civilisation vers une « culture de mort ». Car de son propre aveu, son projet est avant tout politique, s’inscrivant dans la même logique que le vote de la loi de 1975 qui a légalisé l’avortement. Nous voilà prévenus.
« La mort volontaire est un vieux débat philosophique, aussi ancien que l’humain, puisque l’homme est le seul animal à pouvoir se donner la mort » souligne Leonetti avant d’illustrer son propos par la mort de grands hommes : Socrate, Sénèque, Christian de Duve, prix Nobel. Et là, se produit un glissement de terrain dans l’analyse de l’auteur, jusqu’alors riche et sûre : au prétexte du « caractère accepté de la mort » dans ces trois cas , et que chacun ait été assisté en mourant, plus de différence entre le trépas de Socrate condamné à boire la ciguë, celui de Sénèque qui se suicide sur ordre de Néron et celui de Duve qui demande l’euthanasie… Et si on salue la culture gréco-latine et judéo-chrétienne de l’auteur, la pensée structurée du scientifique, l’humanisme de l’élu, on est déstabilisé par cet amalgame périlleux, comme on est heurté en lisant sous sa plume que la loi Veil représente « une protection de l’intégrité de la personne et de la vie ». Mais est-ce un hasard si là encore, le début de la vie est relié à son terme ? En tenant les deux bouts de la chaîne, ne tient-on pas toute la vie ?
Mais Leonetti se veut rassurant : en phase terminale, avec la sédation, le malade « meurt de sa maladie, en dormant profondément et donc sans aucune sensation désagréable et sans acharnement thérapeutique », précisant que la sédation palliative n’utilise pas les mêmes produits que la sédation euthanasique. Mais le malaise persiste, des questions surgissent.
A la lecture de ces deux livres emblématiques, on craint que le débat ne soit confisqué par ses tenants, l’un violent, l’autre sournois, du moins fluctuant, faute d’une conception de la liberté qui soit en lien avec la vérité : qu’est-ce que l’homme ?