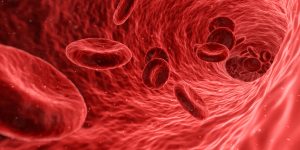Le principe objectif de dignité limite et encadre le droit. Cependant, fragilisé par les évolutions législatives qui introduisent autant de ruptures de cohérence, pourra-t-il encore jouer son rôle de garde-fou ?
L’Espace éthique d’Ile de France organisait le 20 avril dernier un colloque à l’assemblée nationale sur le thème « entre sciences et politique, que peut la bioéthique ? ». A cette occasion, Bertrand Mathieu, professeur agrégé des facultés de droit, s’est interrogé sur les mutations du droit. En effet, sous prétexte de progrès de la science et de la médecine, ou sous la pression sociale, les évolutions récentes interrogent : édicter des règles, se fixer des limites a-t-il encore un sens ?
Gènéthique : Aujourd’hui, quels sont les principes qui régissent le droit de la bioéthique en France ?
Bertrand Mathieu : Pour vous répondre, je prendrai essentiellement en compte les principes constitutionnels. Du fait de leur degré de généralité, ces principes ne sont pas fondamentalement différents de ceux reconnus sur le plan international. J’en mentionnerai deux : la dignité et la liberté, cette dernière étant essentiellement entendue comme le principe d’autonomie de l’individu. Ces deux axes ordonnent le droit de la bioéthique. Il faut leur adjoindre d’autres principes comme le principe d’égalité, le droit à la santé, le principe de responsabilité ou la liberté de la recherche. A prendre aussi en compte, l’une des spécificités du droit de la bioéthique, qui est que ces principes concernent non seulement l’individu, mais aussi l’espèce humaine.
G : Ces grands principes sont-ils toujours d’actualité ?
BM : Comme l’exprime clairement la lettre de saisine du Conseil d’Etat par le Premier ministre, l’une des questions qui se posent est de savoir s’il faut rompre avec ces principes reconnus en 1994 et réaffirmés en 2004 et 2011. En effet leur élasticité n’est pas sans limites et les questions posées peuvent devenir incompatibles avec ces principes.
Faut-il dès lors les maintenir ? Les modifier ? Les remplacer par une conception purement casuistique à l’anglo-saxonne, à laquelle répond parfaitement la notion très souple d’éthique ou de « demande sociétale » et le développement d’un droit presque exclusivement procédural ? Dans ce cas, il n’y aurait plus de limites fixées a priori à l’évolution des techniques et des pratiques. C’est de mon point de vue un choix fondamental qui se fait de plus en plus impérieux.
G : Pourquoi ces principes seraient-ils remis en questions ?
BM : Je ne suis pas compétent pour interpréter les demandes sociétales, je ne suis pas un expert scientifique en la matière, mais le droit doit être facteur de cohérence.
De manière un peu caricaturale, il y deux manières d’ordonner le droit, soit à travers une logique libérale fondée sur l’autonomie de l’individu qui sera peu protectrice, soit par le biais d’une logique fondée sur des principes objectifs. Plus protectrice, cette deuxième option est moins libérale.
On peut essayer de concilier ces deux logiques, cette conciliation résulte notamment du caractère inaliénable des libertés qui interdit de sacrifier sa liberté au nom de la liberté. Mais dans un certain nombre de cas, elles s’avèrent contradictoires.
Le droit ne dit pas de manière absolue, comme le fait une religion ou une morale, ce qui doit être. Il dit ce qui doit être dans un système déterminé, comme je le disais plus haut, il exige une cohérence. Or, plusieurs obstacles mettent à mal la cohésion du droit. Tout d’abord, les questions examinées portent des enjeux économiques importants et le phénomène de mondialisation conduit à ce que les obstacles juridiques posés par le droit étatique soient aisément contournés.
Ensuite, le droit doit s’écarter de deux tentations perverses. La première consisterait à ignorer les données techniques et sociales engendrées par la science et à maintenir contre vents et marées la pureté de règles inadaptées. La seconde conduit le légiste à se limiter à un rôle de notaire transcrivant les avancées scientifiques en règles juridiques sans cesse renouvelées et adaptées.
Enfin, l’architecture du système, conduit le législateur à fixer un cadre très général ainsi que des règles procédurales. La régulation des pratiques est quant à elle essentiellement assurée par des organes indépendants, très largement gérés par des médecins et des scientifiques. Le risque est alors important de voir le fossé se creuser entre des principes immuables inscrits dans le code civil et des dispositions techniques dérogatoires, de plus en plus dérogatoires, inscrites dans le code de la santé publique.
G : Quelle est la portée du principe de dignité ?
BM : Le principe de dignité de la personne humaine a été inscrit dans le Code civil (article 16) en 1994 à l’occasion du vote des lois dites « de bioéthique ». La formulation de ce principe est insérée entre la reconnaissance de la primauté de personne et le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel renvoie au sens même du principe de dignité qui implique que la personne humaine ne soit pas traitée comme un objet (dégradée) à une fin qui lui est étrangère (asservie). Ainsi contrairement à la liberté qui présuppose l’autonomie de celui qui l’exerce, la dignité n’est conditionnée que par l’humanité de l’être qu’elle protège. Aucune autre considération, tenant par exemple à la qualité de la vie de cet être, à ses caractéristiques génétiques, ne peut conditionner la reconnaissance de cette dignité sauf à méconnaître le principe lui-même.
De ce point de vue, le principe de dignité est essentiellement un droit objectif. En ce sens, indépendamment de toute action individuelle en vue de sa protection, il s’impose comme une obligation que chacun doit respecter.
La détermination du principe cardinal de l’ordre juridique, principe de liberté ou principe de dignité, relève d’un choix philosophique. Le choix du principe de liberté implique que la régulation du système social s’opère grâce au principe de responsabilité qui impose la réparation des dommages causés par l’exercice de sa liberté. Le principe de dignité s’affirme comme limite autonome et externe à l’exercice de la liberté. Il crée des limites à l’instrumentalisation et à la marchandisation de l’humain dont la science comme l’économie ont aujourd’hui besoin, soit dans un but altruiste, l’amélioration des conditions sanitaires de la population globale ou la satisfaction des désirs individuels, soit dans un but propre au développement économique.
G : Existe-t-il un autre principe au fondement des lois de bioéthique ?
BM : Oui, je pense au consentement. Il est généralement spécifié que le consentement doit être libre et éclairé. En fait, un consentement qui ne serait pas libre et éclairé serait par nature vicié. Aussi, des formes de consentement dont on peut douter qu’elles présentent en toutes circonstances les caractéristiques d’un véritable consentement, comme le consentement représenté, le consentement préconstitué, ou même le consentement présumé, sont prises en compte par le droit.
G : Si on se place dans la perspectives de la révision de la loi de bioéthique, comment ces principes s’ordonnent-ils sur des questions comme la fin de vie ?
BM : La question de l’euthanasie est aujourd’hui essentiellement posée en termes de revendication d’un droit à obtenir d’un tiers une mort désirée ou souhaitée alors que l’individu se trouve hors d’état de se la donner à lui-même. Si la revendication d’un libre choix du moment et des conditions de sa mort peut être discutée, la formulation de cette exigence en « droit à mourir dans la dignité » est particulièrement contestable. Elle sous-tend l’idée qu’il y a des vies qui, objectivement, ne valent pas la peine d’être vécues, qu’il y a des vies moins dignes que les autres. Or le principe de dignité exprime l’idée selon laquelle il n’y a aucune vie humaine qui n’en vaut une autre. La dignité est une qualité liée à l’humanité, elle ne supporte aucune autre condition.
De manière plus pragmatique, la remise en cause d’un principe tel que celui de l’interdiction de donner la mort à autrui, ouvrirait la voie à bien des dérives.
Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que, s’agissant des personnes âgées, la conséquence directe ou non, assumée ou non, d’une dépénalisation même partielle de l’euthanasie active, serait de contribuer à résoudre les problèmes économiques liés au vieillissement et à la dépendance. L’alternative des soins palliatifs est, par exemple, incontestablement, beaucoup plus coûteuse.
Il convient également d’examiner, en termes de droits fondamentaux, les logiques qui conduiraient à une autorisation encadrée de l’acte d’euthanasie. Au regard de la manière dont le consentement à la mort serait appréhendé (interprétation d’un consentement représenté ou pré constitué au regard de l’état du malade, de la vivacité de sa souffrance et de son espérance de vie…), il apparaît clairement que la décision serait en fait celle du médecin, auquel est associée, le cas échéant, l’équipe soignante. Comme il est habituel en matière de bioéthique, l’exercice d’un tel pouvoir tendrait à être soumis à des conditions essentiellement procédurales. Il n’en reste pas moins que la décision appartiendrait pour l’essentiel au corps médical, comme c’est aujourd’hui le cas en matière d’arrêt de soins. Le médecin, sur lequel repose in fine la décision, est alors confronté à des considérations idéologiques, économiques, hospitalières, idéologiques, familiales qui ne peuvent que rendre plus difficile et plus incertain son jugement. Par ailleurs, il est contestable de traiter de cette question dans une loi de bioéthique qui s’attache essentiellement à des questions thérapeuthiques.
G : Dans un autre domaine, celui de la recherche sur l’embryon, que peut-on dire ?
BM : La recherche sur les embryons humains pose, de ce point de vue, de redoutables questions. D’un point de vue utilitariste, l’utilisation d’embryons humains in vitro à des fins de recherches constitue une pratique qui fait très sensiblement pencher la balance en faveur de l’espoir des bénéfices que représentent les potentialités d’une telle recherche. Si l’on raisonne d’un point de vue ontologique, et si l’on admet que l’embryon est protégé par le principe de dignité, au nom de la personne en devenir qu’il constitue, l’analyse est toute autre. Il s’agit alors d’utiliser un être humain comme matériau de laboratoire à une fin qui lui est totalement étrangère. Le débat est perverti par un renvoi abusif à la question de la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, alors qu’il s’agit dans ce dernier cas d’une conciliation entre la liberté personnelle de la mère et la protection de la vie de l’embryon et non d’une utilisation d’un embryon à des fins collectives.
La logique dans laquelle s’inscrit le droit positif est celle selon laquelle la vie humaine n’est plus appréhendée comme un processus continu que la science reconnaît. C’est une réalité que le droit appréhende par catégories en fonction d’une réalité spatio-temporelle et surtout en fonction du destin que la société ou des individus, je pense notamment à la notion de projet parental en matière d’assistance médicale à la procréation, assignent à cette vie humaine en développement. La distinction de catégories différentes au sein des embryons (pré-embryons, embryons, fœtus…) vise à permettre l’utilisation de l’embryon à un stade de développement peu avancé. Axel Kahn formule sur ce point exactement la question qui se pose : « Comment accepter sereinement que la nature des êtres ou des choses ne dépende que du bon vouloir de quelqu’un ? »[1].
La création d’embryons à des fins de recherche conduit à passer d’une conception opportuniste : il existe des embryons surnuméraires que l’on utilise au lieu de les détruire, à un niveau supérieur, celui d’une conception utilitariste qui conduit à considérer l’embryon comme une chose.
Le cadre fixé par les règles internationales et constitutionnelles est de ce point de vue faussement prescriptif s’agissant de la recherche sur l’embryon. Il est cependant plus fermé à la constitution d’embryons à des fins de recherche : l’article 1 de la Convention bioéthique du Conseil de l’Europe de 1996 interdit la constitution d’embryons humains à des fins de recherche.
G : In fine, quel serait le risque d’un droit fondé sur l’autonomie de la volonté individuelle, limité par les possibilités scientifiques et techniques, et encadré par des contraintes procédurales et des considérations éthiques provisoires ?
BM : Dans un système où l’emprise du droit, et plus encore du droit national, est relativement limitée, le danger serait d’engendrer une profonde inégalité au détriment des plus faibles et de s’inscrire dans une logique utilitariste, de rupture avec des considérations ontologiques ou anthropologiques sur l’humanité. Je pense particulièrement au transhumanisme. De ce point de vue, rien ne s’impose de lui-même, mais la bioéthique constitue en quelque sorte un « jardin d’acclimatation » qui conduit par petits pas successifs, par petites ruptures, à des mutations très profondes, sans que la cohérence de l’ensemble ait fait l’objet d’une réflexion. Peut-être faudrait-il, au-delà d’une analyse casuistique des questions posées par les évolutions scientifiques et techniques, réfléchir sur les valeurs qui fondent des interdits et le prix que nous accepterons de payer soit pour renverser ces interdits, soit pour s’y soumettre ?
Plus juridiquement, les droits subjectifs protègent ceux qui ont les moyens de se défendre, leur infinie multiplication affaiblit chacun d’eux. Les droits objectifs définissent des interdits qui s’imposent à chacun, alors même que la victime potentielle ne peut se défendre. La stratégie, consciente ou inconsciente qui vise à relativiser ou à affaiblir la portée du principe de dignité permet d’éroder le seul obstacle qui se dresse face à l’instrumentalisation de l’homme par l’homme, sous couvert de l’exercice par chacun de sa liberté.
[1] Et l’homme dans tout ça, Nil éditions, 2000, p.84.