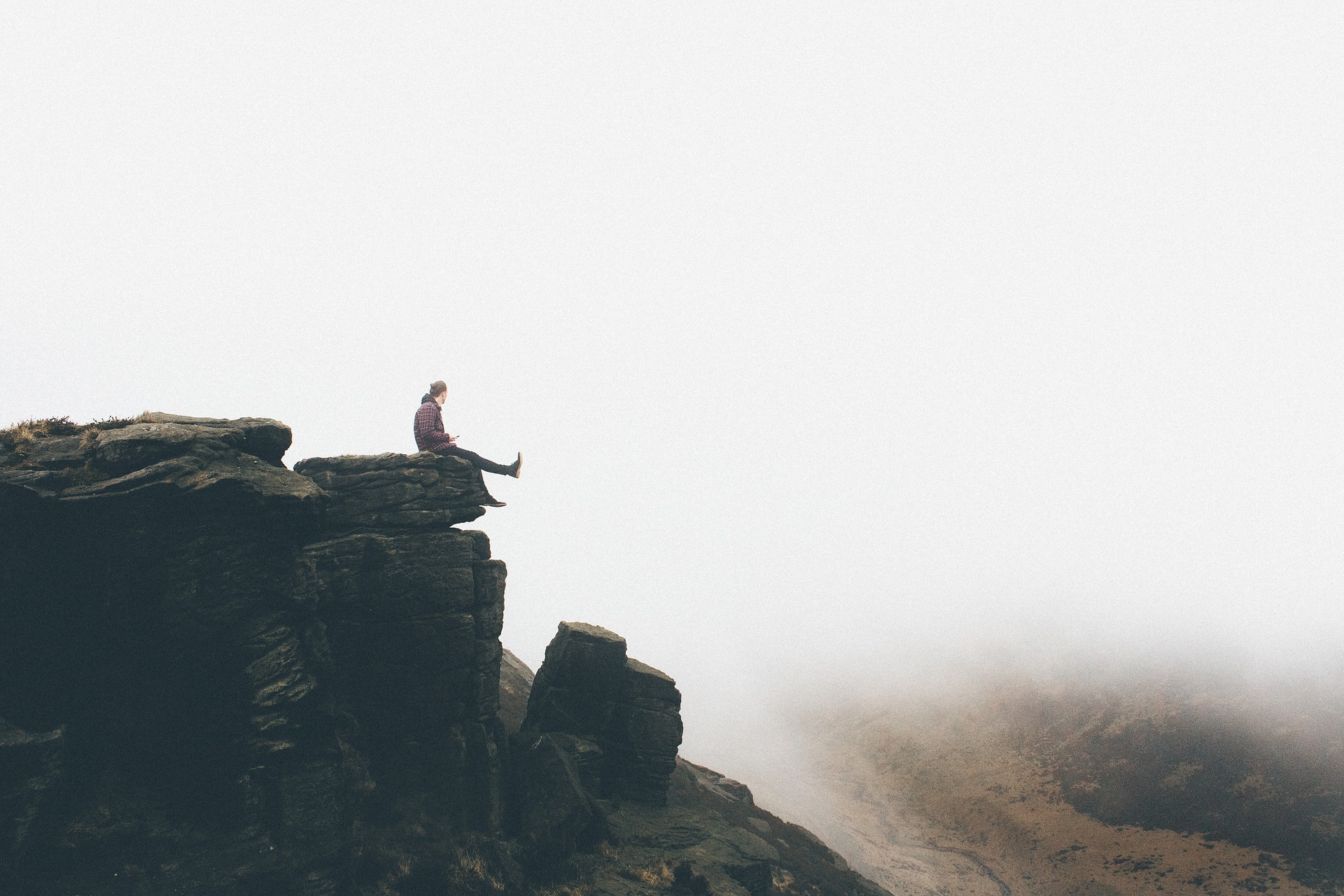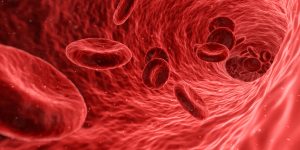Au fur et à mesure des révisions, la loi de bioéthique élargit son périmètre, autorisant largement des pratiques éthiquement contestables, jusqu’ici interdites. Gènéthique a interrogé Bernard N. Schumacher[1], philosophe et professeur titulaire à l’université de Fribourg en Suisse, sur la question des limites.
« Je suis né dans un monde qui commençait à ne plus vouloir entendre parler de la mort et qui est aujourd’hui parvenu à ses fins, sans comprendre qu’il s’est du coup condamné à ne plus entendre parler de la grâce. »[2]
Le poète français Christian Bobin saisit intuitivement que la prétention contemporaine à vouloir que l’individu se suffise à lui-même implique la perte de son aptitude à percevoir le réel comme un don. Si dans une volonté de contrôle, refusant de se laisser affecter par la souffrance, la maladie et plus particulièrement la mort, l’être humain nie sa vulnérabilité, il perd son aptitude à percevoir la réalité, y compris lui-même, comme une réalité donnée, gratuite. Quelle étrange assertion ! Et si le poète avait raison.
Le refus d’entendre parler de la mort, comme de la souffrance et de la maladie, relève d’un refus de consentir à sa profonde vulnérabilité. Ces réalités déstabilisantes remettent en question un des éléments centraux de la culture occidentale contemporaine, à savoir que la liberté humaine serait la libération de toutes les déterminations, limites, contraintes. Une telle construction de la liberté conteste toute réalité qui lui préexisterait et qui la déterminerait, y compris celle de la nature humaine, du corps biologique ou du bien moral, car de telles réalités seraient soupçonnées de réduire la liberté, de l’entraver. « Une liberté émancipée des contraintes de toute forme définitive ou immuable »[3] est revendiquée. Il s’agit de « s’échapper » soi-même des limites imposées par la nature, y compris par la nature humaine, en refaisant ou plutôt en recréant le monde, y compris « ce corps fragile et peu performant » qu’est le corps humain sexué soumis à la maladie, au vieillissement et, en définitive, à la mort. Cette liberté-là promet « qu’une créature va pouvoir faire retour dans la création pour se refaire et se poser comme son propre créateur », et vivre enfin « dans une jouissance sans frein et sans fin »[4]. Le but consiste à s’émanciper des lois écologiques inhérentes à la Nature, en soumettant celle-ci, y compris la corporéité humaine, aux finalités voulues par la liberté. La mort, comme aussi la souffrance et la maladie, viennent rappeler les limites fondamentales de l’être humain.
Le contrôle des limites, respectivement le refus des limites
Une première réponse contemporaine consiste à se soumettre pour le moment aux lois naturelles, inflexibles. La clef du bonheur réside dans la connaissance de ces limites, de ne pas désirer les surpasser et de se contenter de ce qui est contrôlable dans le présent comme le recommande notamment Epictète. Le but consiste à réduire au minimum les désirs qu’on ne peut réaliser par soi-même, afin de ne point souffrir. La projection dans un à-venir qui échappe à la volonté trouble l’âme ; elle craint de ne pouvoir obtenir l’objet de son désir. L’homme devient sage en renonçant, en se contentant des désirs dont il peut atteindre les objets par ses propres forces. Ainsi, le sage se suffit à lui-même, il ne dépend pas d’une altérité pour actualiser ses désirs. Il n’espère pas, car cela impliquerait d’être vulnérable. La raison sous-jacente à un tel refus réside dans l’angoisse d’être déstabilisé, de se trouver dans une situation qui échappe au contrôle de la volonté et qui viendrait restreindre la liberté du sujet, et par là irait à l’encontre de sa dignité même.
Une seconde réponse consiste plutôt à accepter ces limites et notamment la mort dans une attitude qui assume sa radicale finitude. L’angoisse face à la mort ne peut être surmontée et contrôlée qu’en reconnaissant que la structure ontologique humaine se définit par l’être-vers-la-mort. Celle-ci représente la limite établie a priori à partir de laquelle il faut considérer l’authenticité d’une existence humaine. On ne saurait désirer surpasser cette limite. La mort n’est ni un accomplissement ni un terme au bout du chemin, mais bien plutôt une manière d’être de l’homme dans ce monde. L’être-vers-la-mort est ce qui constitue l’être humain dans son individualité.
Une troisième réponse consiste à abolir les limites à l’aide de la technique et de la génétique. La volonté affirme vouloir d’elle-même s’affranchir de la mort, par l’intermédiaire de la raison qui construirait un corps parfait, exempt de toutes défaillances et vulnérabilités. Le transhumanisme se veut le prolongement du projet des humanistes et des Lumières : rendre meilleur l’homme en le libérant de toute hétéronomie, y compris de l’ultime limite à l’autonomie indépendant du sujet que représente le corps, mortel, souffrant, vulnérable. « Nous ne sommes plus contraints d’accepter ce que la nature nous a donné ». La maîtrise de la mort implique au bout du compte que nous ayons « plus de contrôle sur notre propre vie, [que nous en soyons] totalement maître et [que nous puissions] développer le type d’idéal que nous souhaitons »[5]. La suppression de la mort permettrait de se libérer de toutes les limites pour enfin « s’autodéterminer radicalement »[6]. Et Mike Treder de préciser que la promesse de « vivre éternellement, affranchis de toute maladie, souffrance, et déficience physique » implique que nous serons enfin « libres de faire tout ce que nous voulons de nos vies »[7].
Le consentement aux limites
Ces diverses réponses se rejoignent dans leur refus de se laisser déstabiliser par la mort, comme aussi par la souffrance et la maladie, et ce par la volonté de s’en rendre maître. Elles refusent volontairement de dépasser la limite posée par la volonté humaine. Elles se ferment, de propos délibéré, à un surcroît de sens venu d’ailleurs, à une certaine disponibilité de la volonté ; elles craignent en effet d’aller librement au-delà de ce qui est en leur pouvoir ; un tel pas impliquerait une perte de la liberté et les réduirait à un état de mineur. Une telle conception de la liberté qui recherche à tout contrôler réduit la liberté au seul champ du maîtrisable, lequel exclut tout don, jusqu’à celui de la vie. Ou pour le dire avec Michael Sandel dans son récent ouvrage Contre la perfection : l’éthique à l’âge du génie génétique, « mais cette vision de la liberté est erronée. Elle menace de faire disparaître notre appréciation du caractère donné de la vie, et de nous laisser sans rien d’autre à affirmer ou à contempler que notre propre volonté. »[8] Le désir d’immortalité des transhumanistes comme le désir de perfection des enfants ‘fabriqués’ par les généticiens, tout deux mû par le rejet de la limite, peuvent être perçus « l’expression la plus poussée de la démesure qui caractérise la perte du respect de la vie comme un don »[9].
On est ainsi renvoyé à une question anthropologique plus fondamentale : Au cœur de notre humanité, n’y a-t-il pas quelque chose de plus primordial – au plan non pas tant chronologique qu’ontologique – que le contrôle ? La mort annonce plutôt « un événement dont le sujet n’est pas le maître, un événement par rapport auquel le sujet n’est plus sujet »[10], c’est-à-dire un événement envers lequel il est passif et que le sujet n’est pas en mesure d’assumer. « À un certain moment nous ne pouvons plus pouvoir ; c’est en cela justement que le sujet perd sa maîtrise même de sujet »[11]. Face à la mort, comme à la maladie et à la souffrance, et nous pourrions ajouter l’amour authentique, la volonté autonome du sujet doit décider de ne pas pouvoir tout contrôler et de consentir à être touchée et déstabilisée par un monde plus large que ce que l’on peut connaître par la seule raison technique et rationaliste. La volonté doit décider – non pas d’être seulement passive, mais de fournir une réponse active – de recevoir « d’ailleurs », c’est-à-dire d’accepter de ne plus être le maître de ce qui est à désirer et à connaître. En bref, la volonté doit consentir à être vulnérable, à s’ouvrir à ce que l’existence humaine et son avenir ne dépendent pas de son propre pouvoir. Il en va de la liberté même de l’être humain qui ne se définit pas uniquement par une maîtrise assurée du réel, mais aussi et surtout par la capacité d’opérer le choix de se rendre disponible, de recevoir un don et d’y consentir. Pour ce faire, il faut vouloir renoncer au contrôle absolu de soi-même, à l’autarcie. « Nous sommes comme des nageurs qui, se tenant encore debout sur le fond avec un pied, ou un orteil, veulent rester au sol ; si seulement ils lâchaient prise, ils se laisseraient aller glorieusement au plaisir qu’il y a à se laisser porter par l’eau. Si nous pouvions abandonner notre dernière exigence de liberté […], nous connaîtrions la liberté. »[12]
La liberté consiste en dernière instance à se laisser saisir par une réalité qui échappe à la volonté qui contrôle ce qu’elle désire. Elle suppose une réceptivité non passive mais active au sens d’une disponibilité accueillante. L’on est réceptif de manière exemplaire dans l’acte de l’espérance qui est ouverture à ce qui ne dépend pas de la volonté et de la raison humaines, à ce qui leur échappe, à ce sur quoi l’être humain n’a aucune prise. L’espérance est l’instance du non-contrôlable, de la réceptivité du don gratuit au sens radical du terme. Son objet ne peut être accueilli que comme un don. Ceci implique finalement une attitude à l’égard de la vie humaine qui entraîne un apparent paradoxe quant à la liberté humaine. Celle-ci ne se déploiera que dans la mesure où elle accepte volontairement de se dessaisir du contrôle du réel pour se laisser saisir par une dimension qui la transcende ; ainsi de la vie reçue comme don. Une liberté qui renoncerait à s’ouvrir à l’altérité et qui se contenterait de ce qu’elle est en mesure de contrôler, conduirait à dénier la gratuité de la vie. S’ouvrir à la mort, l’altérité par excellence, consiste au contraire à « recevoir la vie comme un don d’une générosité sans prix »[13]. Cette confrontation avec la mort révèle la structure cachée de toute vie : « On ne possède que ce qu’on abandonne et on perd ce qu’on cherche à conserver – réaliser cela, et rien d’autre, tel est ce qu’on exige de l’homme, pour la première et unique fois, au moment de sa mort ; et cependant, également ce qui est rendu possible et dont il est capable : perdre sa propre vie, non seulement ‘en pensée’, non seulement ‘avec de bonnes dispositions’, non seulement de façon symbolique et rhétorique, mais au contraire de façon littérale, réelle – afin de la gagner. »[14]
Une telle confrontation à la mort, c’est non pas l’angoisse du néant, et donc une crispation, qui l’anime, mais l’espérance fondamentale, celle qui permet d’habiter pleinement la vie en l’accueillant, ce qui, se faisant, l’élargit. Même s’il reconnaît que la mort est toujours un mal, l’homme pénétré d’espérance ne s’évade pas dans un au-delà qui l’empêche de s’engager à rendre le monde meilleur. Au contraire, il l’habite pleinement, tandis qu’il reste ouvert à un au-delà, disposé à se laisser inspirer par ce qui ne vient pas de lui.
[1] Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier : L’éthique de la dépendance face au corps vulnérable, sous la direction de Bernard N. Schumacher, Editions érès, 2019.
[2] Christian Bobin, La Présence pure, Paris, Gallimard, 2012, 145-6.
[3] Gilbert Hottois, Le transhumanisme est-il un humanisme ?, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2014, 53.
[4] Israël Nisand, Où va l’humanité ?, Paris, Editions les liens qui libèrent, 2013, 15, 27, 30.
[5] Nick Bostrom, « Entretien avec Nick Bostrom, le transhumaniste en chef », dans Antoine Robitaille, Le Nouvel Homme nouveau. Voyage dans les utopies de la posthumanité, Québec, Les Éditions du Boréal, 2007, 176.
[6] Edgar Morin, L’Homme et la Mort, Paris, Seuil, 1976, 348.
[7] Mike Treder, « Emancipation from Death », dans The Scientific Conquest of Death. Essays on Infinite Lifespans, Immortality Institute, LibrosEnRed, 2004, 190.
[8] Michael Sandel, Contre la perfection. L’éthique à l’âge du génie génétique Paris, Vrin, 2016, 72.
[9] Ibid., 90.
[10] Emmanuel Levinas, Le Temps et l’Autre, Paris, PUF, 1983, 57.
[11] Ibid., 62.
[12] Clive Staples Lewis, Les Quatre Amours, Le Mont-Pèlerin, Éditions Raphaël, 2005, 220.
[13] François Cheng, Cinq méditations sur la mort autrement dit sur la vie, Paris, Albin Michel, 2013, 37.
[14] Josef Pieper, Tod und Unsterblichkeit, dans Werke in acht Bänden, Hamburg, Felix Meiner, 1997, vol. 5, 371.