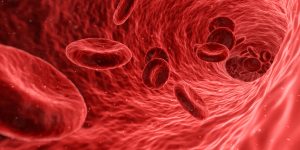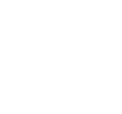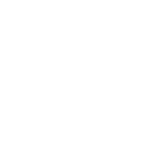Nos sociétés sont influencées par la confusion sexuelle. La théorie du gender constitue la matrice idéologique dont sont issues la plupart des remises en cause portant sur les différences entre les sexes. Lors de l’Assemblée des évêques français à Lourdes, en novembre 2006, la réflexion sur ce sujet a été introduite par un exposé du psychanalyste Jacques Arènes qui explique la théorie du gender (ou genre) et comment y répondre (1).
Les enjeux
La théorie du genre est présente dans les medias et dans le débat public en raison de sa vision politique de la sexualité, en relation avec l’activisme gay. Elle est largement diffusée par la Commission Population de l’ONU et par le Parlement européen, afin d’obliger les pays à modifier leur législation et reconnaître, par exemple, l’union homosexuelle ou l’homoparentalité par l’adoption d’enfants.
Qu’est-ce que la théorie du genre ?
Nées au début des années 70 aux Etats-Unis, les gender studies dénoncent les aspects sociaux de la distinction sexuée, en tant que porteurs d’oppression et d’inégalités. La phrase clé est celle de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient », d’où l’affirmation que la différence masculin-féminin ne coïncide pas avec la différence mâle-femelle.
La notion de genre
Les théoriciens du gender distinguent l’identité sexuelle – faisant référence au sexe biologique – de l’identité de genre, qui désigne le versant social de la différence sexuelle. Pour le féminisme américain, la notion de genre désigne, plus que l’aspect psychologique de l’appropriation de la sexuation, la dimension fondamentalement sociale des distinctions sexuelles.
Vision politique de la sexualité
L’objectif, militant et politique, est de rejeter le déterminisme biologique de la notion de « sexe » ou de différence sexuelle. Les théoriciens actuels du genre insistent sur la violence d’une idéologie où le roc biologique, servirait de caution à une idéologie de hiérarchisation des genres, résultat de l’oppression masculine. Les différences masculin-féminin sont perçues comme aussi détestables que les différences raciales.
Le fait qu’un hétérosexuel puisse se considérer gêné, voire choqué, par l’idée d’une éventuelle pratique homosexuelle est assimilé à l’angoisse du mélange racial justifiant l’apartheid. Le but définitif de la révolution féministe doit être non simplement d’en finir avec le privilège masculin, mais encore avec la distinction même des sexes.
Renverser l’« hétérocentrisme »
L’« hétérocentrisme » est dénoncé, comme système de pouvoir. Les religions, ainsi que certaines approches anthropologiques comme celle de la psychanalyse, sont stigmatisées par les gender studies comme soutenant l’ordre ancien de domination (2).
Comment répondre ?
Dans la vision de la gender theory, tout est pouvoir, rapport de forces. En réponse, il convient de mettre en valeur un discours sur les différences comme lieu d’humanisation et de réalisation du sujet, à penser une différence qui ne soit pas inégalité. Ainsi, au lieu d’opposer « destin biologique » et « liberté », la maternité devient une expérience privilégiée de la responsabilité, un modèle universel d’ouverture à l’autre.
1. La problématique du « genre », Documents Episcopat n°12/2006.
2. Voir par exemple, Au delà du PACS. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, sous la direction de Daniel Borillo, Eric Fassin, Marcela Iacub, PUF, 1999