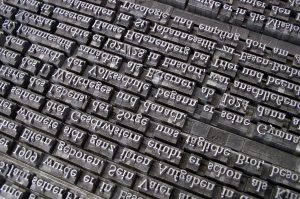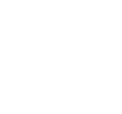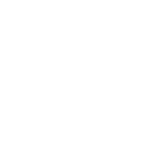Les derniers événements en matière de bioéthique n’ont pas manqué de soulever une vive émotion dans l’opinion publique quant à l’utilité de la recherche médicale.
Les dérives récentes de la science comme l’intention de cloner un être humain ou l’accouchement d’une femme de 62 ans incitent à opter pour une législation ferme. Ces réserves ne doivent pas remettre en question pour autant les progrès de la science en particulier l’obtention de cellules capables de régénérer un cœur à partir de cellules souches adultes. Alors comment concilier science, médecine, éthique et droit ? Pierre Guenancia, philosophe, répond en disant qu’il ne faut pas confondre pratique médicale et recherche médicale. Il va jusqu’à dire : ” l’idée de limiter la recherche médicale fondamentale me paraît contraire à l’idée de science “. Vincent Dielbot, directeur juridique du CHU de Montpellier, déplore quant à lui les lacunes du cadre réglementant la recherche en milieu hospitalier qui reste trop flou. Enfin l’un des autres sujets polémiques évoqué dans l’article est celui de la brevetabilté du vivant.
Pour Daniel Dupret, président de Proteus, société spécialisée en biotechnologies, « l’existence des brevets est la condition sine qua non pour promouvoir le développement de la recherche ». Peu importe pour lui les dérives qui en découlent. Michèle Anahory, avocate, ne partage pas cet avis et estime que le brevet met un frein à la recherche médicale. Plus globalement, elle déplore que la société attende tout du droit pour régler les problèmes éthiques soulevés par la recherche médicale. Reste une question principale sur laquelle il faudra se prononcer si l’on souhaite encadrer la recherche : quel statut donner à l’embryon ?
Le Quotidien du Médecin 08/10/01