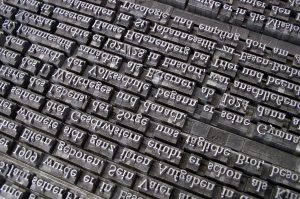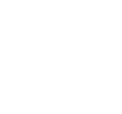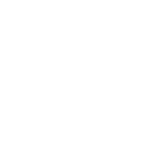En précisant, en son article 45, que "les techniques d’imagerie cérébrale peuvent être employées dans le cadre d’expertises judicaires", la loi de bioéthique de 2011 a ouvert la brèche à un débat dont la question est la suivante : "quel usage faire des conclusions de l’IRM [imagerie à résonnance magnétique] […] dans le domaine judiciaire ? ".
Dans une note parue ce mardi 11 septembre 2012, "le Conseil d’analyse stratégique [CAS] souligne les risques qu’il y aurait à recourir aux techniques d’imagerie cérébrale dans le domaine judiciaire", suggérant "que la Chancellerie soit chargée de clarifier par circulaire l’interprétation de cet article 45".
Ainsi, pour Olivier Oullier, professeur de psychologie cognitive à Aix-Marseille-Université et auteur de la note, "il ne faut pas tourner le dos à cette nouvelle technologie. On ne peut pas nier, en effet, qu’une anomalie anatomique puisse impacter le comportement d’un individu. Il est impératif, en revanche, de savoir exactement quelle place accorder à ce genre d’élément dans le cadre de l’expertise psychiatrique judiciaire. Voilà pourquoi la loi [de bioéthique] doit être précisée". Il ajoute : "je crois, à titre personnel, que l’imagerie cérébrale ne doit pas se substituer à l’examen clinique approfondi d’un accusé mais simplement venir l’étayer. Elle ne peut à elle seule, suffire à fonder l’irresponsabilité pénale de l’accusé". Par conséquent, "le CAS se montre très sceptique" et précise que "compte tenu de l’absence actuelle de preuve scientifique sur la fiabilité de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, cette technologie ne saurait être utilisée comme preuve".
Par ailleurs, dans un entretien, Ali Benmakhlouf, professeur de philosophie à l’Université de Paris Est Créteil Val et membre du Comité consultatif national d’éthique, a "peur" que "les juges et les jurés, qui n’ont aucune compétence scientifique pour décrypter un […] cliché [d’IRM] […], lui confèrent le statut de preuve [et que celle-ci] emporte, à elle seule, leur intime conviction". En effet, précise-t-il, "l’image donne […] le sentiment d’objectiver le fonctionnement cérébral. Mais c’est une illusion : on ne peut réduire la complexité du psychisme humain à un cliché". A la question du journaliste : "ne croyez-vous pas qu’un jour l’imagerie cérébrale sera sollicitée pour évaluer la ‘dangerosité’ supposée des détenus en fin de peine", Ali Benmakhlouf répond : "Nous y viendrons peut-être. Mais soyons conscients de ce que cela implique : croire que les comportements humains sont prédictibles revient à ravaler notre humanité au rang de simple animalité. Cela revient à annihiler toute forme de responsabilité. Croire que l’on peut biologiser à ce point les comportements humains, c’est avoir une vision bien réductionniste de l’homme".
La Croix (Dominique Greiner) 11/09/12 – AFP 11/09/12