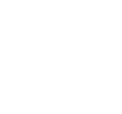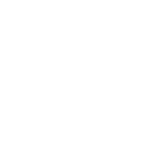La Croix consacre son dossier Sciences et éthique au cerveau humain. L’occasion pour le quotidien de se pencher sur les récentes découvertes sur le cerveau, sur le traitement des maladies neurodégénératives et sur le projet européen Human Brain Project, pendent et concurrent de l’américain Brain Initiative.
Sur les maladies neurodégénératives, La Croix fait un bilan des pistes de traitements en cours. Ainsi, le journal évoque :
-
Les recherches du Salk Institut (La Jolla) sur les cellules iPS, « fabriquées » à partir de cellules prélevées chez des personnes atteintes d’Alzheimer ou de Parkinson, afin de « reconstituer l’histoire des cellules nerveuses » jusqu’à la mort neuronale.
-
L’essai clinique ACT utilisant des cellules souches embryonnaires (Cf. « Gènéthique vous informe » du 17 octobre 2014).
-
Les neuroprothèses, mises à l’honneur par le prix Lasker 2014 remis à Amin-Louis Benabid, neurochirurgien au VHU de Grenoble, « inventeur de la technique de stimulation cérébrale profonde ». Les neuroprothèses sont implantées chez le patients, via une opération chirurgicale, est stimulent le noyau profond du cortex cérébrale afin de réduire les troubles moteurs d’un malade atteint de Parkinson. Cette méthode s’étend à d’autres maladies dégénératives.
La Croix rappelle l’origine du Human Brain Project européen et les difficultés qu’il rencontre. Lancé par Henry Markram, professeur de neuroscience à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en 2013, Human Brain Project a été pensé pour stimuler le cerveau par voie informatique. Pour Markram, « la modélisation serait une nouvelle voie, à côté de l’expérimentation et de la théorisation, pour stimuler la conscience ».
Cependant, des critiques ont émergé portant à la fois sur la gouvernance, la gestion financière et même sur le fond du projet. (Cf. synthèses Gènéthique du 9 juillet 2014 et 18 septembre 2014) « On se laisse emporter par l’attrait technologique aux dépens d’une réflexion scientifique poussée » déclare Yehezkel Ben Ari, fondateur de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée. Par ailleurs, l’abandon du volet initial concernant les neurosciences cognitives, c’est-à-dire « toute la partie expérimentale, in vitro, chez l’animal ou chez l’homme permettant de valider les modèles », suscite également des critiques.
La Croix (Denis Sergent) 04/11/2014